
William H. Gass, Le Tunnel, p.14
Hier soir, les paupières closes sur moi-même, je me suis mis à voir comme si j’étais une fenêtre ouverte. Livré aux vents. Je ne reposais pas dans une paisible obscurité, cette obscurité à laquelle j’aspirais, cette paix dont j’avais besoin. Ma tête résonnait de mille feux, plus désolée cependant qu’un jardin en hiver : les pensées vaguaient et volaient en tous sens tels des papiers gras puis disparaissaient. Il y avait des avenues foulées par des pas invisibles, des bruissements sans feuilles ni arbres, des aboiements détachés de leurs chiens.
p.333
Un livre, écrivis-je, est comme une galerie de fenêtres ; chaque page perçoit un monde et raconte sa fortune ; chaque page même faiblement reflète le visage de son lecteur, et transmet un jugement ; chaque page est faite d’esprit, et c’est ce même esprit qui perçoit le monde extérieur, et c’est ce même esprit qui reflète un monde intérieur, et c’est ce même esprit qui se tient dans sa transparence entre la perception et le reflet, unissant et divisant, jouant un double jeu.
(Le Cherche Midi, traduction Claro)
Tiphayne Samoyault, « L’occupation des temps »
Du temps a passé sur les longs romans. J’ai passé du temps à les lire. Ils sont signes pour moi de l’époque révolue où je passais du temps à les lire. Ils rythmaient mon temps, les détours, au sortir de l’école, du côté de la bibliothèque municipale où je lisais par « œuvres complètes » et indifféremment Zola, Mazo de la Roche ou Jules Romains. Ils appartiennent à leur temps de longs romans qui correspond à un moment de l’histoire littéraire, un entre-deux-guerres, où l’on a su prendre le temps pour les lire sans qu’on comprenne bien pourquoi d’ailleurs : pourquoi ce temps-là, où les urgences étaient déjà grandes, et brûlantes et où commençait à être compté le temps du monde, et des hommes ? Du temps a passé sur les longs romans qui ont identifié le temps à leur cours, qui ont fait de l’histoire, de ses ruptures récentes et bientôt à venir – naguère et demain – le présent ininterrompu de ce qui devenait leur matière : ce qu’il y avait à raconter et à dire quand il était encore temps.
(Études sur Waltenberg, p.240, Editions l’Act Mem)
C’est la vie de William Frederick Kohler, historien. Un jour, caché des hommes et de sa femme, il se met à creuser un tunnel au sous-sol de sa maison, cependant qu’en haut, dans le bureau, l’introduction de son livre – la dernière pièce de son chef-d’oeuvre – se transforme en introspection de sept cents pages. Autre forage, mêmes secrets.
Impossible de dire à quiconque: ceci est mon trou. Ceci est mon sublime éden personnel. Vous ne l’admirez donc pas? N’est-il pas grandiose?

Résonances : Kafka pour le Terrier; Céline pour la vocalité et la syncope; Bernhard, l’autre imprécateur, pour le ressassement et la mise à nu (à l’os) de toute chose qui a de la chair ; Pynchon pour le va-et-vient musée haut / musée bas, culture savante / culture populaire, préciosité / vulgarité, pour l’énaurmité des références philosophiques, historiques, littéraires ; Sterne : le récit comme renaissance problématique, le goût de la digression sans fin, les jeux typographiques ;


les campus novels aussi, pour le flingage méthodique de ses collègues de papier (dissolution de l’empiriste Planmantee, destruction de l’idéaliste Governalli, éreintement du poète dominical Culp ; sans oublier « ce cher Herschel », le raté qui, « seul au milieu de toilettes publiques, paraitrait quand même perdu dans la foule »), pour les intrigues d’alcôves, les scolastiques disputatio.

Et Rabelais, et Flaubert, Joyce, etc.
C’est un « roman-monde » comme on dit parfois des plus ambitieux textes venus des Amériques (l’Arc-en-ciel de la gravité, 2666, la Maison des Feuilles, d’autres que j’oublie…) depuis qu’on ne dit plus « roman-total » en Europe, où la moyenne s’est raccourcie. Si « monde » est ce qui se trouve dans la tête d’un homme quand un écrivain sait le mettre sur une feuille. Ou si « monde » est tout ce qui se trouve à l’intérieur du mot.

Il y a ces résonances et tous ces précédents, et tous ces héritiers, mais la voix de Gass est unique. Pas de plan labyrinthique (en apparence), pas d’étayage virtuose (ouvertement virtuose, ostensiblement virtuose), mais des aplats comme des coups de pelle. Tout est dans la phrase, lyrique et ravageuse, qui n’élève que pour abîmer. La métaphore (objet de sa thèse de doctorat) exile, abat, creuse sous le texte, et fait sombrer le monde familier. On n’est jamais chez soi dans la prose de Gass.
J’ai lu le Tunnel non pas une mais deux, trois fois, car j’ai relu bien des phrases une fois, deux fois. Je relirai encore
« Un jour, un de ces jours, il n’y aura plus de jour. »
« Ce n’est pas une autre journée. C’est la même au carré. Pas moyen d’échapper au froid, à la grisaille, à l’horloge, au désordre, aux pièces mal chauffées, à l’heure de la répétition, aux pensées obsessionnelles, à mes crimes innocents, aux martinets ramoneurs pareils à des tâches dans les yeux.
J’erre dans la maison. Désœuvré. Les escaliers. Ils descendent. Je grimpe. Les fenêtres. Je regarde dehors. Dans la salle à manger, un conclave de chaises vides. De la lumière dans l’évier comme des gouttes d’eau tombées d’un robinet qui fuit. Autrefois, la moindre pacotille nous rappelait notre mariage, quand nous achetions du bonheur aux enchères, et une cuiller à sucre remuait un souvenir dans un autre, le café dans le lait, le rêve dans le désir. Et que nous faisions des choses quand nous n’avions pas d’argent mais avions des mains. »

« Quel calme. Les lumières ont déserté le bâtiment – comme je devrais le faire – et les couloirs vont joindre leurs échos aux miens. »
« La graisse a alourdi ses hanches et ajouté des bastions à ses seins. »
« Mon sentiment pour elle, comme une fine sueur, me glace en séchant. »
« L’hiver s’attarda si longtemps que leurs crocus fleurirent sous la neige, que nos jonquilles moururent en terre, et que le soleil rêva. »
« Les parcs cernaient les gens de tant d’espace. »
C’est quand il parle du Midwest, et plus encore de sa maison, et plus encore de l’hiver, le cœur du cœur de son pays, son véritable enfer, que Gass est le meilleur, nettement meilleur, me suis-je dit (un moment idiot), que quand il voyage dans l’Europe des années noires, dont il ne parvient pas – malédiction américaine – à faire autre chose qu’un barnum grotesque, grossier, hollywoodien même, et même si c’est avec un talent bouffon, au second, au troisième degré. Peut-être n’y a-t-il plus mieux à faire.
Quel acteur pour jouer l’infâme Magus Tabor, universitaire sulfureux, grandiloquent oracle de l’histoire-dite-par-un-idiot-pleine-de-bruit-et-de-fureur ?

Où reconstituer les rues de Berlin une Nuit de Cristal ?
Qui pour filmer, en travelling, les pavés luisant de verre brisé ?
Kohler lui-même?

Voilà, lisant le chapitre Kristallnacht, maugréant contre ce qui m’apparaissait comme un temps faible du texte, le genre de questions que je me posais. Avant d’être cueilli
La fumée semblait le symbole muet du cri.

Au milieu de ces volutes de bile noire et de ces monceaux de ruines, je me suis délecté à chercher les traces (il dirait sans doute « flaques », j’aurais pu écrire « preuves ») de lumière. Des restes de bonheur dans la solitude de l’enfance.
p.34
Il s’absenta un temps, mais quand la menace de son absence eut diminué je pus alors regarder sereinement autour de moi les herbes, les fougères, et les arbres ; et, dans un silence si complet que mon souffle semblait une brise, je pus sentir la qualité du moindre frémissement dans leurs frondes délicates et leurs tiges fines. Il y avait des herbes pareilles à des chevelures folles, du lierre inlassable, des graines pourpres et dorées, des clochettes bleues. Les coupes pleines des trous d’eau scintillaient comme des cuillers à thé, et je voyais clairement des grains de sable rouler lentement sur le fond d’où la lumière s’élevait tel un nuage de vapeur, tandis que l’eau elle-même semblait se tenir au-dessus de la roche érodée comme si elle était de l’air – une autre atmosphère – , le médium d’une existence autre. Je me penchai sur les fonds, étudiai la mousse et les vairons, suivis le lit du cours d’eau le long de ses rives douces et tièdes, vis une feuille semblable à un baigneur (attitude on ne peut plus inadaptée à ma nature) et m’emparai prestement d’un éclat de soleil – j’t’ai eu.

L’épiphanie me rappelle Rousseau, le rêveur solitaire en sa deuxième promenade. Il reprend connaissance après avoir été renversé par un gros chien sur les pentes de Ménilmontant
La nuit s’avançait. J’aperçus le ciel, quelques étoiles, et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j’apercevais. Tout entier au moment présent je ne me souvenais de riens ; je n’avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m’arriver ; je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais ; je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j’aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m’appartînt en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel, chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l’activité des plaisirs connus.
Quant aux fenêtres

Elles sont belles, mais sombres, aussi belles et sombres que celle d’Au cœur du cœur de ce pays, quand Gass écrit
ma fenêtre est un tombeau, et tout ce qui s’étend dans son champ est mort.
Il y en a beaucoup au long du Tunnel, grandes fermées sur l’extérieur, à la transparence louche, car Kohler dit avoir « armé son cœur » de haine et s’être entouré « d’un mur d’indifférence dépourvu de grille afin qu’on ne le franchisse jamais».
Une partie entière

leur est explicitement dédiée :
Trois espaces comptent dans ma vie ; ils forment ma trinité ; le carreau de la fenêtre, le blanc de la page, et le noir du tableau. J’aimerais ajouter, le corps de ma bien-aimé, mais je ne peux pas.
La fenêtre par laquelle je regardais alors, la fenêtre qui ne m’offrait rien, soir après soir, nuit après nuit, aube après aube, était également toutes les fenêtres que j’avais connues, qu’elles fussent réelles ou mélancoliques.
Depuis cette fenêtre je peux voir le poil rêche de notre jardin sous la neige, et plus loin, derrière une haie dépouillée, l’étendue plate et gelée du pré où parfois mes enfants font du patin ; puis, beaucoup plus loin, telle une brume grise, des arbres.

Je referme le livre dans un état incertain. Que se passe-t-il quand le pacte est rompu entre la voix qui parle et celle qui lit, et que la langue qui nous abreuve de tant de plaisir fait entendre tant de foi mauvaise et de haine recuite ?
Il fait alors si noir de l’autre côté qu’on ne voit plus par la vitre que son propre reflet.
Si les gens n’aimaient pas en moi ce que je n’aime pas en eux, je ne les détesterais pas. Nous serions parvenus à une compréhension.
Depuis trois semaines qu’il m’accompagne, je me demande comment Gass a pu couver son Kohler pendant près de trente ans.
Il a déjà répondu à ce genre de question :

Better to have him on the page than inside of you.
Dans la critique du New York Times où j’ai trouvé cette citation, Robert Kelly écrit aussi: « It is not a nice book. It will have enemies, and I am not sure after one reading (forgive me, it’s a big book) that I am not one of them. »
Je ne suis pas sûr pour ma part qu’il ne me laisse pas (mais pour d’autres raisons) aussi désarmé que son personnage face à son tas de feuilles
Mon livre, Das Meisterstücke. Le but de ma vie était de l’écrire, et le voilà posé à ma gauche tel un verre vide.
Images:
Paysage du Midwest français par la fenêtre du train, par Fabien Darrouzet ; Le Terrier de Kafka, par Robert Crumb et David Zane Mairowitz; détails du Tunnel; Disputatio, vers 1500 (auteur inconnu); The World within the word, recueil d’essais critiques de William Gass, détail de la couverture; Hopper, A woman in the sun, 1961; Michael Gambon et Matt Damon dans The Good Shepherd, de Robert de Niro (2006) ; Clint Eastwood, Gran Torino (2008); le Cri, d’Edvard Munch, 1893; Rousseau herborisant à Ermenonville, auteur inconnu; Façade d’immeuble à Bruxelles, par Romain Bonnaud; Midwest français (2), par Fabien Darrouzet; William H. Gass, auteur inconnu.
PS :
Peut-être faut-il commencer par là, chez Libellules : superbe article sur le sujet Gass et l’objet Tunnel, sa poésie, sa traduction.

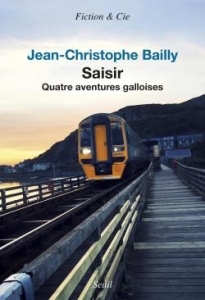





 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 




































