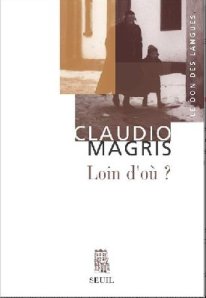Avant-propos de la revue Ecrire l’histoire :
«Ecrire l’histoire, la raconter, la peindre, la filmer, la jouer, la chanter, ou encore la figurer, défigurer, reconfigurer – et ainsi toujours la penser, la repenser dans la manière dont elle s’écrit. S’écrivant, elle réengage à chaque fois la question de son sens, mais aussi de ses domaines. Soit ce qui est avéré, ce qui est « effectivement arrivé », comme disent avec Ranke les historiens positivistes, mais encore ce que les représentations du passé intègrent, reconnaissent comme des objets possibles, légitimes, découpant ainsi dans le champ infini de la réalité les frontières, à chaque moment réinterrogées, de ce qu’on nomme l’histoire »
Catherine Coquio, « Raul Hilberg et Saul Friedländer, Deux politiques du détail », Ecrire l’histoire, N°4 « Le détail (2), p.73 :
« Mais c’est l’Allemagne nazie et les Juifs, sa structure fuguée fortement signifiante, son écriture polyphonique et contrapuntique, qui me font ici parler d’écriture au sens fort. On peut le faire aussi sans abus lorsque on lit comme un diptyque La Destruction des Juifs d’Europe et Exécuteurs, victimes, témoins, livres que leur auteur a d’ailleurs référés à un modèle artistique, musical pour l’un (les composition de Beethoven, à l’opposé du brio mozartien), pictural pour l’autre : ses visites silencieuses dans les musées d’Europe auraient inspiré son désir d’écrire un jour une galerie de portraits (La Politique de la mémoire, chap. « Un art », « Le triptyque »). Et c’est dans les récits et les descriptions ramassées de son recueil de portraits, puis dans la dureté caustique de son autobiographie que l’écriture de Hilberg se révèle avec le plus d’éclat. »
Le premier numéro de la revue a été publié au printemps 2008, sous les bons auspices d’un comité d’honneur où apparaissent entre autres Stéphane Audoin-Rouzeau, Arlette Farge, Pascal Ory, Krzysztof Pomian, Anne-Marie Thiesse, Jay Winter.
« Ecrire l’histoire » parce que ne pouvant dire l’ensemble infini des faits passés (voyez déjà Joyce face à la journée de Bloom, Perec au carrefour Mabillon) l’histoire se compose, sélectionne, met en forme et qu’ainsi elle n’est jamais complètement innocente et toujours un peu poétique. Depuis 2008 donc à chaque année son thème en deux volets (printemps-automne), et après deux premiers numéros consacrés aux « émotions », les deux volumes de 2009 examinent l’usage des « détails ».
Du détail, nous dit Claude Millet dans son avant-propos, car il est toujours construit et signale les hiérarchies parfois inavouées. Ce faisant il dévoile une éthique (ou son absence quand tel fait devient « un détail de l’histoire »). Du détail aussi parce que son usage est un révélateur d’une forme de « détotalisation » du récit historien qui a en apparence renoncé depuis une vingtaine d’années aux grandes explications et aux vastes fresques indexées sur les fluctuations du temps long, pour s’attacher plus directement aux individus (mais ils étaient là autrement chez Braudel et consors), à leurs pratiques circonscrites dans un temps court et un espace restreint. La critique des sciences humaines, l’émiettement de l’histoire des années 70, sont passés par là. La microstoria aussi, même si, on va le voir, des approches nouvelles, ne renonçant ni à la petite ni à la grande échelle, ont donné naissance à des travaux qui fondent précisément leur ambition totalisante sur le souci du détail. Le réel n’est-il pas, si l’on en croit Michon, « un obus de petit calibre »?
Le troisième numéro de la revue, premier volet sur le sujet, est étrangement introuvable. Au cœur du numéro 4 paru en octobre, en une belle mise en pages (un petit format presque carré, deux colonnes par pages), il y a neuf articles: du refus des détails chez Voltaire historien, de son usage chez Dumas, dans la bande dessinée historique, dans les tableaux du peintre parodique Spitzweg etc… Une traduction d’une étude de Carlo Guinzburg (issue d’un livre à paraître en français) sur le style direct libre chez Stendhal et le défi qu’il lance à l’histoire et aux historiens.
Je retrouve aussi les deux compères Pierre Bergounioux et Pierre Michon. Un entretien avec Bergounioux, qui rattache son « tour d’esprit vétilleux » à des déterminations socio-géographique : le goût du détail, un trait des gens de peu, un tour des périphéries longtemps anhistorique, pour qui les « idées générales sont des idées de général ». Une brillante analyse des Onze de Michon par Paul Petitier (le détail comme effet de scène davantage que comme effet de réel, mise en question de toute histoire positiviste). D’autres lectures d’écrivains (Jean Rolin, Daniel Mendelssohn) complètent les incursions dans le domaine de la prose littéraire.
La dernière partie de la revue, « histoire de carte », propose trois contributions érudites sur l’histoire de la cartographie, l’histoire dans la cartographie.
Un article me retient particulièrement. Catherine Coquio compare deux politiques du détail à l’œuvre chez deux grands historiens, Raul Hilberg (mort il y a deux ans) et Saul Friedländer. Deux rescapés, deux orphelins de la Shoah.

Du premier la Destruction des Juifs d’Europe (1961) a été un de mes grands chocs de lecture et c’est à mon sens une des très grandes œuvres de l’esprit du siècle passé. Je me souviens des heures plongé dans l’univers dément et glacé de la machine d’extermination nazie, guidé par la prose d’Hilberg, d’une absolue sobriété et d’une absolue rigueur (comme un défi). Des organigrammes, des tableaux statistiques, des notes en bas de pages toujours plus fournies et plus scrupuleuses, fruits d’un travail monumental effectué dans les années 1950, par un jeune chercheur qui avait fui le nazisme, seul au milieu des montagnes d’archives allemandes.


J’ai découvert le second plus tard, et je n’ai lu pour l’instant que le premier des deux tomes de l’Allemagne nazie et les Juifs. J’ai vu et entendu Friedländer il y a deux ans à Paris, au cours d’une conférence à la Sorbonne, défendre sa méthode, expliquer comment son regard s’était déplacé des arcanes de l’Etat nazi à l’espace social tout entier dans lequel a eu lieu la catastrophe.

L’attention portée à la grande échelle (c’est-à-dire aux territoires les plus restreints, aux acteurs pris en tant qu’individus) autant qu’à la petite (l’Etat, les classes sociales) passe comme chez Hilberg, par la lecture des décrets, des discours, mais fait une part plus décisive encore aux témoignages, aux entretiens, aux journaux intimes. Elle s’appuie aussi sur l’analyse poussée (une herméneutique) des images et des gestes. L’ensemble, porté par une langue admirable, construit une phénoménologie de la persécution et de la destruction qui ne cède à aucun moment au pathos.

Catherine Coquio s’arrête en particulier sur l’usage d’une photographie par Friedländer : un étudiant hollandais, une étoile de David cousue à son costume, est fait docteur en médecine de l’université d’Amsterdam le 18 septembre 1942, une semaine avant l’exclusion prévue des juifs de l’université, et plusieurs semaines après le départ des premiers convois vers les camps d’extermination. Le détail photographique provoque l’incrédulité, l’interrogation, tout en signalant l’acte de résistance d’une partie du corps enseignant. La démarche permet de garder vive l’insurrection de l’esprit et de la morale au sein de l’œuvre de science.
Au prisme du détail, l’article fait finalement apparaître une forme de conversion de Hilberg, qui résume l’évolution de toute l’historiographie (et pas seulement celle de la Shoah) depuis les années 1950. Au seuil de ses recherches l’historien américain a d’abord fait porter ses efforts sur le choix des archives et l’analyse minutieuse des documents officiels, ce qui lui permet de montrer le caractère progressif (par paliers) du processus d’extermination, à bien des égards décentralisé et anarchique. Le souci du détail administratif et statistique était alors au service d’une histoire totale du projet nazi. Au cours des années 70-80 la lecture du Journal de Czerniakov, président du conseil juif de Varsovie, et la rencontre avec Claude Lanzmann le font basculer dans une autre politique du détail, qui donne son Exécuteurs, victimes, témoins (1994), série de portraits, de types, de « groupes » qui témoigne de sa volonté de retrouver les « gens ». Son attention se tourne vers les individus, vers leurs gestes quotidiens, impensés, révélateurs de l’ordinaire à l’œuvre dans l’extraordinaire de la Shoah. La Politique de la mémoire, l’ouvrage d’ego-histoire de Hilberg, dont l’article se nourrit largement, raconte ainsi le passage de l’histoire « d’en haut », dont aucun mécanisme ne nous est caché, à l’histoire « d’en-bas » dont aucun micro événement n’est plus jamais anecdotique. La trajectoire a pu paraître à certains comme un renoncement. Loin d’y voir un « petit livre » à côté de la magistrale Destruction, Catherine Coquio invite plutôt à les lire comme un diptyque monumental.

L’articulation du détail et de la vue d’ensemble, de la partie et du tout est en effet particulièrement lisible dans Exécuteurs, victimes, témoins. On y trouve une forme de simplicité: des catégories, des sous catégories, des personnages, des destins parfois décrits en quelques lignes, parfois en une page, parfois plus (Hitler). L’alternance rythmique (long-court, général-particulier) est soutenue par la régularité du plan (huit chapitres pour chacune des catégories, vingt-quatre en tout) et par la sobriété du style. Les transitions entre les cas, les échelles d’analyse, sont discrètes mais efficaces: les décisions et les destins personnels en apparence déconnectés prennent, une fois montés (on est pas si loin de l’art de Brecht), un sens historique, poétique et éthique. La prose de Hilberg dit une colère rentrée, pour laquelle les faits bruts valent en tant que jugement. La présentation des cas prend parfois une dimension parabolique (par où les exemples deviennent des exempla).
La première partie s’achève sur les exécuteurs non-allemands. On lit les dernières lignes :
« Le 24 février, un incident se produisit au 19ème bataillon de Schutzmannschaft (letton). Une jeune recrue présenta une requête au commandant, le lieutenant Robert Osis, pour être mutée dans la Police de sécurité. En présence d’un des ses collègues, le lieutenant-colonel Karlis Lobe, Osis demanda au jeune homme pourquoi il préférait tuer des Juifs plutôt que de servir dans une unité régulière, au milieu de vrais guerriers. Lorsque le garçon répliqua qu’il voulait aller au front, Osis lui dit qu’aucun membre de la Police de sécurité ne se battait là-bas. Il ajouta qu’il était trop jeune pour tuer des Juifs. Si lui, Osis, accédait à sa requête, que ferait ce garçon dans dix ans, lorsqu’il rêverait de cadavres de Juifs? Sur quoi la recrue se plaignit par voie officielle, citant les commentaires méprisants que s’étaient autorisés Osis et Lobe sur la Police de sécurité. L’affaire fut portée devant les commandants allemands de la Police de sécurité et de la Police de l’ordre, responsables de la région de la Baltique-Biélorussie. Lobe fit valoir, pour sa défense, que le plaignant n’avait que dix-sept ou dix-huit ans, qu’il voulait abattre des Juifs et que lui, Lobe, lui avait dit qu’il n’était pas apte à faire ce travail. Lobe savait de quoi il parlait. Au cours de l’année précédente, il avait personnellement dirigé l’« action de nettoyage » du secteur de Ventspils et Kuldiga. » (p.164-165, traduction Marie-France de Paloméra)
Pas d’autre conclusion que le point final, et le lecteur est laissé seul face à cet imbroglio hiérarchique.
Et c’est ainsi, nous dit Catherine Coquio, qu’Hilberg rejoint ou plutôt « fraye le chemin » à Friedländer, en mettant au jour l’absurdité au cœur même du processus de destruction, ce « besoin d’habitude », cette indifférence morale, mais aussi les « incidents », les atermoiements que leur résolution bureaucratique rend encore plus effrayants et pathétiques, et que seule une analyse au ras du sol permet de voir.
On songe à d’autres catastrophes. Ce n’est pas un hasard si dans sa Révolution russe 1891-1922 (extraordinaire expérience de lecture qui fait parcourir en une vaste fresque les territoires, les classes sociales, le monde des idées, l’économie, la politique politicienne, les pratiques religieuses, culturelles, la violence toujours sous-estimée de ces années), Orlando Figes a choisi une démarche comparable à ses collègues spécialistes de la Shoah, qui mêle le désir d’embrasser l’ensemble d’un problème sur de vastes territoires et de larges périodes, tout en ménageant une place importante, décisive même, à la voix de ceux qui étaient jusque là restés sans voix.

Les Chuchoteurs, Vivre et survivre sous Staline, son dernier travail dont la traduction française a paru cet automne, pousse encore plus loin le projet, qui semble vouloir faire sortir l’historiographie de ses gonds puisque c’est uniquement par des portraits issus des témoignages de personnes encore vivantes, recueillis par ses soins où ceux de ses assistants, que Figes rend compte de la mise au pas stalinienne de l’URSS dans les années 30.
A Hilberg et Friedländer on pourrait donc ajouter Figes. Lignée par où l’histoire se rattache, conclut l’article, à la littérature. Et Catherine Coquio de noter que l’ironie discrète et amère, la froideur apparente des description, la mise au jour des souffrances humaines oubliées – ou jusqu’alors inaudibles – disent une désespérance immense qu’un autre historien et survivant, H. G. Adler, avait immédiatement repérée, et qu’un écrivain comme Bernhard a systématiquement cultivées. Quant à moi je comprends mieux l’admiration que j’ai portée à la Destruction des Juifs d’Europe.

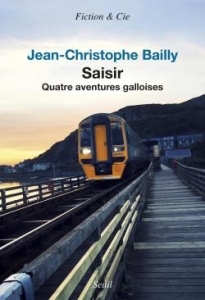





 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 



































 La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…
La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…