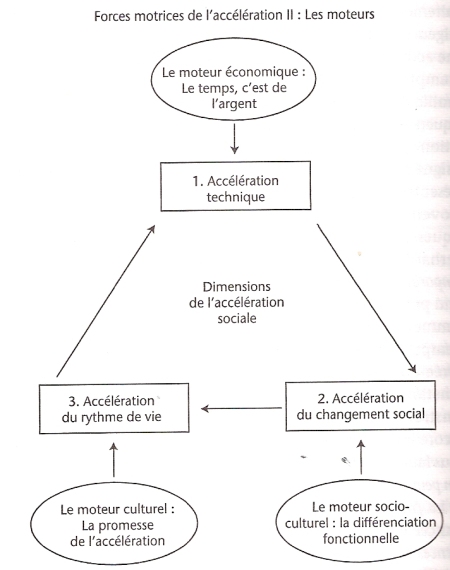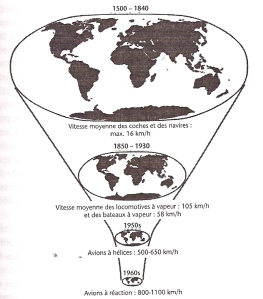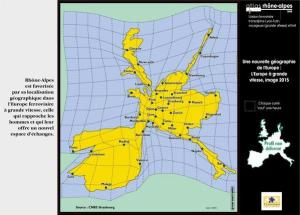Pierre Bergounioux, Carnet de notes 1980-1990, p.7
Ma 16.12.1980
Levé avec une heure de retard. Paul, qui pousse une dent, nous a tenus éveillés longtemps, cette nuit.
Commandé L’Histoire universelle des explorations.
Ce cahier parce que je sens que s’effacent, à peine posées, les touches légères qui confèrent aux heures de notre vie leur saveur, leur couleur. Il ne subsiste plus, avec l’éloignement, que des blocs de quatre ou cinq années teintées grossièrement dans la masse. J’aimerais bien avoir conservé quelques lignes du temps d’avant – d’avant la conscience du monde et de soi, de la fièvre et de l’urgence, de la certitude de mourir. Mais c’est parce qu’elle m’étaient épargnées que je n’ai pas éprouvé le besoin de rien noter.
(Verdier, 2006)
Carnet de notes 2001-2010, p.1263
Ve 31.12.2010
Le ciel bas, la froide grisaille font écho à la désolation de l’âge qui est désormais le mien.
(Verdier, 2012)
C’est la fin du troisième Carnet de notes, découvert début janvier dans ma librairie favorite, avec d’autant plus d’émotion que j’avais entamé, depuis quelques mois, une nouvelle relecture – à petites doses celle-là – de la première décennie de son journal. Je retrouve, coulées dans le même moule, les notes prises quotidiennement ou presque, relation scrupuleuse des travaux et des jours, dans une langue dont la perfection hors d’âge confère de l’exotisme aux événements les plus banals, exprime l’essence tragique des petits et grands malheurs. On pourrait s’amuser, d’un volume l’autre, à mélanger les jours et les années. Le style et les soucis demeurent, intacts. Il n’y a en un sens ni début, ni fin, seuls le cycle des saisons, les allers-retours, le sentiment de la perte.
Par exemple: de quand dater ce crépuscule matinal ?
Levés à cinq heures et demie. Nous descendons en Corrèze mais c’est pour y rencontrer d’autres motifs de tristesse. Je ne vois plus que désolation, partout. J’ai trop vécu.
Du 22.12.1989. Le premier tome.
Les Carnets m’accompagnent depuis ce printemps 2006 qu’ils ont commencé de paraître et que j’ai lu ces premières lignes que je cite en exergue. Un moment de ma vie où je ne pouvais pas ne pas m’y reconnaître. J’avais trente ans, j’étais (je suis toujours) enseignant, mon fils Pierre poussait une dent, etc…. Et puis le temps du livre a creusé, en neuf cent cinquante pages et quelques jours, dix ans entre nos deux vies. J’y suis par la suite retourné maintes fois, pour éprouver à nouveau mêlées la sensation du retour et celle de l’éloignement. Depuis ce mois de mars d’il y a bientôt six ans, parmi les quelques règles tacites et bien peu contraignantes qui rythment mon existence, s’est ajoutée celle-ci : chaque année au moins une année, au hasard, des Carnets de notes. Parfois, c’est une des deux décennies entières qui y passe, et ce « parfois », souvent dans les moments difficiles.
Dans ce dernier volume, Bergounioux creuse encore l’écart de l’âge, mais il me rejoint au moment où je le découvrais,
Lu 6.3.2006
J’arrive à la Maison de la radio, entre par la porte B. Marianne Alphant est déjà là. Geneviève Méric vient nous chercher. Rejoints par Tiphaine Samoyault et un jeune critique. On se rend au cinquième étage où nous attendait Pascale Casanova. Je n’avais pas compris que la totalité de l’émission porterait sur le Carnet, ce qui me gêne et me rend gauche, brouillon.
à d’autres que j’ai le souvenir d’avoir vécus comme lui,
Je 24.1.2002
Ronan Calan m’appelle vers une heure pour m’annoncer la mort de Pierre Bourdieu. J’en éprouve un douloureux chagrin. Toute la journée en sera obscurcie. C’est l’esprit majeur de notre temps qui nous quitte, sans avoir eu son jour.
se rejoint lui-même dans l’écrivain qu’il aspirait à être, qu’il est devenu. Se rattrape définitivement, dans sa dernière année, quand il retranscrit, de ses cahiers à l’ordinateur, les mois qui viennent tout juste de s’écouler, et prend doublement la mesure du mal qui attaque son corps et accable son esprit.
Aucune œuvre ne m’a donné ces dernières années le sentiment, la sensation du temps, si ce n’est, sur un mode tout différent, ramassé, accéléré, surplombant, Les Années d’Annie Ernaux.
Lu 4.2.2008
Je le lis avec la sensation de parcourir, mais chaussé de bottes de sept lieues, tout ce à quoi nous avons été mêlés et qui s’en est allé, si bien que presque plus rien ne rappelle, aujourd’hui, les paysages que nous avons découverts, traversés, le goût de ce qui fut, à n’en pas douter, la réalité.
Non pas simplement le temps qui passe, en réalité, mais le temps comme matière épaisse et ductile : cette « masse » dont parle Bergounioux, dans laquelle on sculpte, tant bien que mal, la forme d’une vie.

Trajectoires de transfuges, parallèles, seulement décalées de quelques années,  qui ont mené deux êtres venus de la périphérie géographique et sociale à devenir des professeurs de banlieue parisienne, vite déçus, désillusionnés, bientôt en quête de s’appartenir dans l’écriture,
qui ont mené deux êtres venus de la périphérie géographique et sociale à devenir des professeurs de banlieue parisienne, vite déçus, désillusionnés, bientôt en quête de s’appartenir dans l’écriture,
Les Années, p.158
Parce que dans sa solitude retrouvée elle découvre des pensées et des sensations que la vie en couple obnubile, l’idée lui est venue d’écrire « une sorte de destin de femme », entre 1940 et 1985, quelque chose comme Une vie de Maupassant, qui ferait ressentir le passage du temps en elle et hors d’elle, dans l’Histoire, un « roman total » qui s’achèverait dans la dépossession des êtres et des choses, parents, maris, enfants qui partent de la maison, meubles vendus.
(Gallimard, 2008)
mais obligés de disputer au temps domestique le temps nécessaire à ce qu’Ernaux appelle les « vraies pensées », celles qui peuvent un jour mettre en branle la machine littéraire
Les Années, p.99
C’est l’approfondissement de sensations fugitives, impossibles à communiquer aux autres, tout ce que, si elle avait le temps d’écrire – elle n’a même plus celui de lire -, serait la matière de son livre.
Deux écrivains qui tentent de dire le temps d’une vie dans le temps du monde social, sans sacrifier à ce que Bourdieu nomma dans un de ses plus beaux textes « l’illusion biographique », tenant le point de vue d’en haut et celui d’en bas, à ceci près qu’Ernaux écrit après, Bergounioux pendant, plongé au milieu de ses semblables dans la position du reclus. L’œil ouvert, mais de plus en plus affligé par ce qu’il voit.
Me 16.5.2007
Un peu plus tard, à la station-service, le type qui s’approvisionnait à la pompe voisine, démarre en trombe pour me passer devant dans la file d’attente au guichet. Sur sa figure, le sourire heureux, irrépressible de qui a réussi son coup, se réjouit du petit préjudice profitable qu’il vient de perpétrer. C’est cette détérioration des mœurs, cette dégradation de la moralité publique qu’entérine l’élection de Sarkozy. Il est comme ces gens. Ils se retrouvent en lui.
Me 14.11.2007
Il me semble faire, continuellement, l’expérience des grands écroulements à quoi ressemble la marche du temps lorsqu’on atteint un certain âge.
Au cours de cette dernière décennie, fidèle reflet des précédentes, Pierre Bergounioux a passé le plus clair de son temps à écrire, lire
Sa 20.8.2005
Je lis Le Naufragé de Th. Bernhard
Ma 30.8.2005
Je lis Mon année dans la baie de personne de P. Handke
Sa 21.6.2003
Je lis, pour la troisième fois, Le Sens pratique, qui est sans doute l’ouvrage philosophique majeur du XXème siècle.
Di. 14.3.2010
Osselets de F.-Y. Jeannet
Sa 9.9.2006
Je lis Austerlitz de Sebald
en silence.
Je 16.9.2004
J’ai pu dire dix mots dans la journée, à l’employée du rayon de charcuterie et à la caissière. Ça me suffit, désormais.
Il a continué à enseigner, comme on boit une potion amère,
Ve 20.6.2003
Oui, j’ai eu le sentiment persistant, depuis septembre, de m’adresser à des êtres privés non seulement de raison mais aussi et surtout de compréhension, du minimum requis d’empathie, de pour-autrui, de compassion. Ce sont les deux principales facultés, l’esprit et le cœur, que les conditions d’existence dont ils sont le produit ont altérées, atrophiées.
s’est inquiété, beaucoup
Di 13.5.2001
Je songeais, ce matin, sur le boulevard Montparnasse, que près de vingt ans s’étaient écoulés depuis que Paul était tombé malade et que, chaque jour, pendant trois semaines, nous nous étions tenus à son chevet, à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
3.10.2003
Ceux que j’aime sont sur les routes
endeuillé, à creuser un ulcère dans son corps déjà maigre.
Trente ans entre les lignes écrites à la fin de 1980 et celles qui closent ce troisième volume.
Le doute s’est installé.
Me 11.6.2008
Il me semble avoir perdu la capacité de lire douze à quatorze heures d’affilée comme je faisais, depuis toujours.
Ma 29.89.2006
Prétendre garder trace, comme je fais, du passé relève de l’enfantillage.
Di 26.12.2010
Il était raisonnable, quand j’étais jeune, de garder trace de ce que j’avais découvert, pour celui que je serai plus tard. Mais depuis quelque temps, les signes de la fin se multiplient et j’ai bien peur de n’avoir plus l’usage de ce registre.
Cathy, la « fée de son adolescence », veille toujours.
Paul et Jean ont grandi.








 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier