Thomas Bernhard, Béton, p.154
Sans doute n’ai-je, toujours à nouveau, pas pu commencer mon travail uniquement parce que les livres et les écrits n’étaient pas bien rangés sur ma table, me suis-je dit.
(Gallimard, traduction Gilberte Lambrichs)
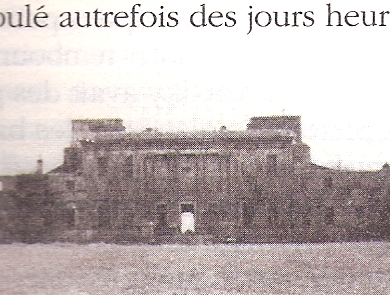
Thomas Bernhard, Corrections, p.379-380 :
A Altensam, la nuit, la voracité des vers du bois l’a empêché de dormir, partout et la nuit, comme il est naturel, la finesse de son ouïe et son cerveau ultra-sensible lui ont fait entendre avec la plus grande netteté le ver du bois au travail ; dans les lattes et sous les lattes du plancher, dans les armoires et les commodes, principalement dans toutes les armoires à tiroirs, selon Roithamer, dans les portes et les croisillons des fenêtres et même dans les pendules, dans les chaises et les fauteuils, il a toujours pu distinguer exactement où et dans quel objet, dans quel meuble un ver du bois était au travail ; effectivement le ver du bois s’était même déjà creusé une galerie dans son propre lit ; pendant qu’il restait éveillé dans son lit toute la nuit, ainsi écrit Roithamer, il avait suivi, il avait été obligé de suivre le travail des vers du bois avec l’attention la plus grande, il avait respiré l’odeur douceâtre de la poussière de bois fraîche et il avait dû constater avec accablement qu’au cours des années des milliers, il se peut des dizaines et des centaines de milliers de vers du bois s’étaient attaqués à Altensam pour, comme il avait été toujours forcé de le penser durant la nuit, ronger Altensam, grignoter et ronger Altensam jusqu’à la dernière parcelle, et le ronger tout le temps nécessaire jusqu’à ce qu’en un seul instant, qui peut-être ne se fera pas tellement sentir, il s’effondre sur ses bases.
(Gallimard, L’Imaginaire, traduction Albert Kohn)
W. G Sebald, Les Anneaux de Saturne, p.259-260:
Bientôt, on fut obligé d’abandonner les étages supérieurs voire des ailes entières et de se retirer dans quelques pièces encore praticables au rez-de-chaussée. Les fenêtres des étages condamnés se ternirent derrière les toiles d’araignées, la pourriture sèche gagna du terrain, les insectes transportèrent les spores du champignon jusque dans les angles les plus reculés, des moisissures brunes violacées et noires présentant des formes monstrueuses, parfois grandes comme des têtes de bœufs, apparurent aux murs et aux plafonds. Les planchers commencèrent à céder, les charpentes des toitures à ployer. Boiseries et cages d’escalier, depuis longtemps pourries en dedans, tombaient parfois dans la nuit en poussière jaune soufre. Les catastrophes, sous forme de soudains effondrement intervenant le plus souvent après de longues périodes de pluie ou de sécheresse ou, d’une manière générale, lorsque le temps changeait, se produisaient au beau milieu de ce processus de désagrégation rampant, devenu pour ainsi dire la norme, donc quelque chose qu’on ne percevait même plus et dont la progression d’un jour à l’autre était d’ailleurs pratiquement imperceptible.
(Actes Sud, traduction de Bernard Kreiss)

Et je pensai de nouveau qu’il eût beaucoup mieux valu lire mon Gogol et mon Pascal et mon Montaigne, ou jouer du Schönberg ou du Satie, ou encore tout simplement arpenter les rues de Vienne.
(Folio, traduction de Bernard Kreiss)
Troisième édition, déjà, de mon palmarès annuel et personnel, très personnel, pas toujours – pas souvent – « sur le fil de l’actualité culturelle », comme dit quelqu’un à la radio. De certains des livres qui suivent j’ai cru pouvoir dire des choses qui n’auraient pas encore été dites, d’autres seulement citer quelques passages. Il y en a que je n’ai voulu (pu) qu’admirer en silence. Voici en tout cas ceux qui me sont restés et qui reviendront sans doute dans les années qui viennent à côté de ceux que je relis compulsivement depuis des années.
Dans l’ordre chronologique de leur apparition:
– Saul Friedlander, Quand vient le souvenir
– Orlando Figès, Les chuchoteurs
– Eric Chauvier, Contre Télérama
– Julius Margolin, Voyage au pays des Ze-Ka
– Alix Cléo-Roubaud, Journal
– H. G. Adler, Un voyage
– Emilio Gentile, L’Apocalypse de la modernité
– Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être
– Daniel Clowes, Wilson
– Jack Kerouac, Sur la route, le rouleau original
– Thomas Bernhard, Perturbation
– Tony Judt, The Memory Chalet
– Frédéric-Yves Jeannet, Charité
– Mireille Calle-Gruber, Claude Simon, une vie à écrire
– Anton Tchékhov, Drame de chasse
– Arno Schmidt, Scènes de la vie d’un faune
– Paul Nizon, Le livret de l’amour
– Thomas Bernhard, Des arbres à abattre
– enfin celui que je viens de refermer: le court essai d’autobiographie de Thomas Bernhard, encore et toujours lui, intitulé Trois jours, dont j’extrais ceci
Dans mon travail, quand apparaissent quelque part les signes avant-coureurs d’une histoire, ou simplement quand je vois se dessiner quelque part au loin, derrière une colline de prose, un soupçon d’histoire, je tire à vue.
qui me ramène tout droit à mes considérations d’il y a un an.
Éric Chauvier, Contre Télérama, p.46
Nous nous sommes demandés, faussement naïfs, qui était réellement « au cœur du sujet » ; puis nous avons vérifié que notre usage de la première personne du pluriel était beaucoup plus pertinent puisque nous étions réellement – pour en voir parlé et être tombé d’accord là-dessus – « au cœur de notre sujet ».
(éditions Allia)
Éric Chauvier, Que du bonheur, p.42
Cette situation d’infélicité peut lui permettre de remettre inlassablement en jeu la valeur de sa représentativité. Comment puis-je parler au nom des autres ? Comment ceux-ci peuvent-ils parler en mon nom ?
Thomas Bernhard, L’imitateur
Mais quand nous lui avons suggérer d’imiter, pour finir, sa propre voix, il a dit que cela, il ne pouvait pas le faire.
(Traduction de Jean-Claude Haméry, Gallimard, Quarto, p.576)
Contre Télérama se présente sous la forme de notes dans un carnet, assemblées avec soin. A première vue elles dépeignent le quotidien d’une zone résidentielle pour classes moyennes supérieures, dans la périphérie d’une grande ville française. Un environnement en apparence sans qualité, aliénant, grotesque.
La particularité de notre rue est d’être à la fois très droite et très large.
D’autres questions sont apparues concernant l’absurdité proprement philosophique de remplacer un bois véritable (l’expression même est dissonante) par des maisons en bois, pour des raisons écologiques.
Cette recherche systématiquement contrariée de ce que nous nous figurons être l’authenticité nous condamne malgré nous au kitsch et à la parodie.
La charge contre le magazine (contre un article : « Halte à la France moche ») n’intervient qu’au dernier quart du livre. De ce fait elle apparaît davantage comme un retournement de situation – un coup de théâtre – que comme une démonstration point par point. Le papier n’est par ailleurs jamais discuté dans le détail, toujours réduit à son titre, lu comme le manifeste méprisant de ceux du centre pour ceux de la marge. En réponse, la colère de Chauvier rend un son bernhardien, mi-sincère, mi-outrée, comique et glaciale.
Son ambigüité en fait le prix. Rien n’est tout à fait clair ni vraiment embrouillé. On est bien dans l’entre-deux (une prose périurbaine?).
Les remarques sont à la fois précises et floues, alternant
coup d’œil affuté
Une bande herbeuse très verte est apparue au milieu d’un parking, entre les pavillons, non loin d’un bois de hêtres.
vagues repérages
notre zone pavillonnaire
dans le quartier
une enclave semi-rurale
des zones boisées
cette « zone dans la zone »
considérations générales,
Notre aliénation a des limites, mais le footing ne les relève pas.
références érudites
Bibliographie
Adorno Theodor W., Minima Moralia, Paris, Payot, 2003
Austin John, Ecrits philosophiques, Paris, Seuil, 1994
Bernhard Thomas, L’Imitateur, Paris, Gallimard, 1981
Cavell Stanley, Les Voix de la raison, Paris, Seuil, 1996
De Certeau Michel, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1990
Marcuse Herbert, L’Homme unidimensionnel, Paris, Minuit, 1968
dans un texte qui oscille sans cesse entre journal intime et journal de terrain, lettre ouverte et « pensées pour moi-même », obligeant l’esprit à de constantes mises au point.
L’observation neutre, au présent, laisse parfois surgir le passé et fait alors entendre une émotion plus franche, cependant toujours tenue en laisse par le ton analytique
Si nous nous sommes replongés dans ces souvenirs, c’est parce que ce voisin, par les mots qu’il a prononcés, par les gestes qu’il a eus, par la communication qu’il a jugé bon d’établir avec nous, nous a semblé avoir fait partie de ces enfants qui jouaient au pied du lit des morts.
Et puisqu’il est question d’esthétique, la métaphore littéraire s’impose à l’occasion. Finalement rien ne l’égale:
La vie périrubaine – son atmosphère ordinaire – est semblable à une épaisseur de neige tombé sur nos pavillons, insonorisant toute forme de vie qui pourrait s’en échapper, mais cloisonnant la vie singulière de chacun de ses habitants comme les agissements de putains dans un bordel.
Comme dans ses précédents livres, Éric Chauvier s’est donné un point de vue imprenable en se mettant dans une situation impossible.
Son « nous » est glissant : à l’évidence ce n’est plus tout à fait celui de l’ethnologue, seul en son royaume au milieu des tribus lointaines. Ce nous royal, il le raille, même si l’on croit l’entendre encore un peu, par-delà toutes les critiques, désignant Éric Chauvier lui-même, anthropologue de son quotidien, se dépouillant sous nos yeux de sa majesté scientifique (et comme c’est une solution toujours un peu trop simple que de faire coïncider l’auteur du livre et la voix qui s’y exprime (et puisqu’il est question de l’Imitateur) le lecteur se demande à bon droit si Chauvier ne fait pas parler une sorte de double bernhardien).
Le plus souvent, les choses paraissent assez claires: la première personne du pluriel le représente « lui et sa famille », ses enfants, sa compagne. « Lui et elle » discutent beaucoup d’ailleurs. Et même si « elle » change parfois, sans crier gare, on reste toujours dans l’entre-soi.
Il semble cependant, dans de rares passages, que « nous » affiche de nouvelles prétentions (si l’on peut dire) et puisse être lu comme « lui et ses voisins », ses compagnons d’infortune, tous les périurbains de France, réunis par une double opprobre venue d’en-haut,
venue d’en-bas
Car nous incarnons, aux yeux de ces autochtones, une sorte de vie parodique, que notre pouvoir d’achat, élevé ou non, ne pourra jamais rendre vraiment crédible.
Mais alors
Comment peut-il dire « nous », celui qui ne parvient que trop rarement à prendre langue avec ses voisins, dont les tentatives pour mobiliser la communauté s’échouent presque toujours sur l’apathie politique générale?
Comment peut-il mener la fronde, celui dont le statut social, la cérébralité sans relâche, les pratiques culturelles, les jugements de goût, s’avèrent plus téléramesques que nature?
La question demeure insoluble, et c’est assez logique, car là n’est pas la question. En fait c’est peut-être moins le « nous » que le « vous », contenu dans le « moche » et dans le « périurbain », qui pose problème.
On le découvre par un autre (et le mystère s’épaissit encore) :
Il comprenait que l’adjectif « périurbain » ne désignait rien de précis et, au demeurant, ne désignait pas grand chose si ce n’était, étymologiquement, la périphérie de la ville ; il s’agissait par conséquent d’une boîte noire ; par contre, affirma-t-il, « l’usage de ce mot est tout à fait clair, il révèle une stratégie destinée à amalgamer ce qui ne saurait l’être – c’est-à-dire nous-mêmes – afin de nous contrôler sans limite ».
Une « boîte noire », « rien de précis »? Ni un lieu, ni un non-lieu, semble dire Éric Chauvier. (Un non-non-lieu, pour parodier Marc Augé ?). Quoiqu’il en soit, les scrupules et les doutes abondent quant à la possibilité – à la pertinence même – de nommer ces espaces, et ces scrupules et ces doutes contrastent de manière frappante avec l’assurance des géographes et des statisticiens, qui de leur côté en ont donné depuis longtemps une définition assez stable et claire, désarmante plutôt qu’inoffensive (l’auteur s’en méfie), propre en tout cas à être utilisée par ceux qu’on nomme les décideurs : par « périurbain » ils désignent la partie la plus périphérique de ce que l’on nomme maintenant les « aires urbaines », un espace à dominante résidentielle, dont le bâti – c’est la différence avec la « banlieue » – se caractérise par sa discontinuité interne (formes en lambeaux, phénomènes de mitage)
et externe (séparé de ce qui reste « le centre » par des parties plus ou moins vastes de… de quoi au fait? campagne?), tout en étant rattaché à la métropole par des liens politiques, économiques, et par la mobilité quotidienne (au moins 40% des actifs d’une commune périurbaine, disent les statisticiens et les géographes, travaillent dans la ville-centre de l’aire urbaine ou dans une autre commune périurbaine). Ainsi parle-t-on de « communes polarisées » et même de «communes multipolarisées » pour évoquer ces entités évoluant dans l’orbite des grandes métropoles françaises.
Or c’est en ce point précis que Chauvier porte sa critique de la raison géographique, car c’est justement ce dernier lien avec l’espace dominant, la relation avec la « ville-mère », qui apparaît singulièrement lâche, et même brisé, dans son texte. D’abord parce que son projet est né précisément d’une réaction contre un « centre » perçu comme arrogant et aveugle ; ensuite, de manière plus diffuse, parce que l’espace décrit dans Contre Télérama semble curieusement autosuffisant, et d’autant plus fragile. Comme une bulle un peu irréelle, hors du temps et de l’espace, une cellule devenue autonome, détachée de sa matrice. Par où Chauvier rejoint d’autres travaux au potentiel plus subversif (Henri Lefebvre, Françoise Choay, François Ascher) qui ont annoncé, observé, théorisé, critiqué (mais pas toujours), depuis un demi-siècle, la disparition de la ville – et avec elle une certaine forme d’urbanité – dans autre chose, qui n’est pas forcément très ragoûtant, mais qui est là : l’urbain.
Eric Chauvier donne à voir cette transformation de l’intérieur, et, ce faisant, il prête sa voix dissonante (il emploie ce mot fréquemment) à une colère d’ordinaire sourde et vaine, toujours isolée. Celle de ceux qui ne veulent pas que leur malheur soit nommé par d’autres.
Contre Télérama est une protestation qui s’élève de l’urbain, mutilée, désenchantée, mais pas tout à fait diluée dans le silence de ces espaces infinis. Écho fidèle à celle qu’Adorno faisait entendre il y a cinquante ans, tout juste revenu de son exil étasunien
Minima Moralia, p.27
Celui qui a pris ses distances est aussi empêtré que celui qui est plongé dans des activités ; son seul avantage sur ce dernier, c’est de savoir qu’il est pris lui aussi, avec cette chance de liberté minuscule qu’apporte la connaissance en elle-même.
(traduit par Eliane Kaufholz et Jean-René Ladmiral, Payot, Petite bibliothèque)
Il est minuit. La pluie fouette les vitres. Je suis calme.
(Minuit, Collection double)
Ne tombe pas, ne t’écroule pas !, me dis-je, je me tiens encore droit, ma faiblesse, cette faiblesse que je redoute, je ne la montre pas, il faut bien que j’arrive à destination, à mon bureau, ma radio, ma table, aux papiers portant les phrases Pour vivre quelque chose, je fis un voyage en Allemagne, il est minuit, derrière moi marche l’étranger.
Cette fois, j’avais choisi le chemin de fer comme moyen de transport. Je voyageais dans le wagon-restaurant, filant onze heures durant vers une victoire certaine. C’était par une journée printanière d’hiver, le Vormärz en plein mois de janvier, alternativement et parfois en même temps il tombait de la neige et de la pluie, des paysages détrempés, petites inondations, je voyais des prairies submergées, de petits nuages volant bas déchiquetés par la tempête, des trous de ciel bleu se reflétant dans l’eau qui inondait les pâturages, des villages et des fermes isolées ; puis à nouveau des zones très peuplées, des installations militaires, casernes, camps, camions garés alignés l’un derrière l’autre, des voies ferrées secondaires, des tanks ou des pièces d’artillerie chargées sur des wagons ou autres ustensiles nécessaires pour le maintien d’un minimum de paix. Sympathique cette description.
(Editions Absalon, traduit et présenté par Bernard Banoun)
Werner Kofler me fait penser à Thomas Bernhard qui aurait dérapé et décroché de sa paroi. Dans Derrière mon bureau il y a d’ailleurs « Bernhard, Thomas » himself, encordé à son guide, mais ce dernier hésite à lâcher le boulet souffreteux dans le grand vide.
J’entends un même rire sardonique, les même coups de pioche entêtés dans la terre d’Autriche, dans celle d’Allemagne, sur les crânes autrichiens, allemands, pour découvrir, sous les couches sociales-chrétiennes-démocrates, les couches nationales-socialistes.
Les bureaux ont toujours joué un grand rôle, sinon le plus grand, dans l’histoire allemande
Des citations de Bernhard, entre autres, sont semées un peu partout : « mon cher Pascal, mon cher Montaigne, etc. ». (« Mon cher Beckett », écrit Kofler de son côté.)
Dans le train qui traverse l’Allemagne au milieu du livre, c’est semble-t-il encore dans l’esprit de Bernhard (incognito) que l’on entend résonner « les lambeaux de conversations » attrapés ici ou là à l’intérieur du wagon-restaurant, sur le fond de sa propre pensée, ou celle de l’auteur – mais l’auteur se cache sous beaucoup d’identités : Tobias Reiser, Christoph Willibald Gluck, l’auteur Schmidt – dans un tourbillon vertigineux et parfaitement virtuose, aussi virtuose que la prose de Bernhard, qui tourne le dos à l’impeccable emboîtement des discours rapportés qu’on trouve dans les textes de Bernhard.
La relecture corrosive est le meilleur des hommages.
M’avez-vous lu dans Maîtres anciens ? Vous m’avez certainement lu dans Maîtres anciens, un cheval de bataille, dit-on… La canne coincée entre les genoux, sur la banquette de la salle Bordone du Kunsthistorisches Museum, et c’est parti la rhétorique de la destruction, la poésie des tables de verdicts, la canonnade d’injures, en avant ! c’est parti ! Il me suffit de dire : Ce pays est une fosse d’aisances de bouffonnerie, ou bien Chaque matin tant de bouffonnerie nous fait monter la honte au visage, et la critique littéraire allemande, le Michaelis du Zeit ou cet autre crétin de la Frankfurter Allgemeine, j’ai oublié son nom, tous crient à la révélation, à l’ébahissement littéraire.
(…)
C’est naturellement un plaisir que d’être le héros d’un livre placé si haut, et que m’importe la parfaite incompétence des thuriféraires.
(p.121)
Chez Kofler, comme chez Bernhard et chez les plus grands imprécateurs, à l’inverse des plus médiocres d’entre eux, on n’a jamais le sentiment rassurant d’être du bon côté. Ni l’auteur ni le lecteur ne peuvent contempler le troupeau humain avec la clairvoyance factice du grand esprit – le grand esprit se met alors à ressembler au petit vieux de certaines bourgades – accablé de tant de bêtise, bien à l’abri derrière sa fenêtre. Leur clairvoyance, elle se trouble vite; le troupeau, tous deux en font partie.
La dernière page venue, on ne sait plus qui est le maître, où est le guide.
Devant moi marche le guide de montagne. Derrière moi marche l’étranger. Non, c’est moi l’étranger. Autrement: derrière moi marche le guide de montagne, devant moi marche l’étranger. Non plus, le guide de montagne est considéré comme disparu. Devant moi, donc, marche l’étranger. Connait-il le chemin?
Je ne connaissais pas Werner Kofler. Je dois sa découverte à Pascale Casanova, qu’on n’entend plus sur France Culture. Ce que j’en ai appris : il est né en 1947, une quinzaine d’années après Bernhard. Il a commencé à publier à peu près en même temps que son maître ancien, au début des années 1960. Depuis il trace sa voie, imperturbable.
Il est minuit. La pluie fouette les vitres. Je suis assis derrière mon bureau.
Thomas Mann, La Montagne magique, p.120-121
Sur la nature de l’ennui, des conceptions erronées sont répandues. On croit en somme que la nouveauté et le caractère intéressant de son contenu font « passer le temps », c’est-à-dire : l’abrègent, tandis que la monotonie et le vide alourdiraient son cours. Mais ce n’est pas absolument exact. Le vide et la monotonie allongent sans doute parfois l’instant ou l’heure et les rendent « ennuyeux », mais ils abrègent et accélèrent, jusqu’à presque les réduire à néant, les grandes et les plus grandes quantités de temps. Au contraire, un contenu riche et intéressant est sans doute capable d’abréger une heure, ou même une journée, mais, compté en grand, il prête au cours du temps de l’ampleur, du poids, de la solidité, de telle sorte que les années riches en événements passent beaucoup plus lentement que ces années pauvres, vides et légères que le vent balaye et qui s’envolent.
(Livre de Poche, traduction de Maurice Betz)
Hartmut Rosa, Accélération, p.175
Ce phénomène bien connu sous l’expression de « paradoxe du temps subjectif » s’explique aisément : les épisodes de vécu ressentis comme intéressants laissent des traces mémorielles plus fortes que les épisodes « ennuyeux », leur contenu mémoriel plus riche est donc interprété comme une extension du temps remémoré et inversement.
En revanche, un autre phénomène que je propose, à la suite des remarques d’A. Barth, de désigner comme « paradoxe de la télévision », est bien moins étudié. Il montre que le temps passé devant la télévision (par exemple, devant une série policière) présente, pendant que l’on regarde, toutes les caractéristiques du temps vécu bref (grande densité de stimuli, implication émotionnelle, élévation du pouls, de la pression sanguine lorsque l’assassin entre en scène ou que le buteur s’apprête à tirer un penalty, et sentiment du temps qui « fuit à tire-d’aile ») pour se transformer, dès que l’on a éteint le téléviseur, et à plus forte raison dans les remémorations, en expérience vécue du temps long : « il n’en reste plus rien », le temps du souvenir s’amenuise rapidement, ce qui explique pourquoi les sujets font état, une fois l’émission terminée, d’un sentiment de « grand vide » (…)
La télévision semble donc avoir tendance à produire, face aux modèles de l’expérience vécue du temps « traditionnelle », un modèle bref-bref inédit et paradoxal, même si ce n’est pas toujours le cas.
(La Découverte, traduction par Didier Renault)
De leur Zauberberg à la vue imprenable sur la matière temporelle, Hans Castorp et ses compagnons se livrent à diverses observations et expériences dans l’espoir de percer le mystère de la durée, cependant qu’au même moment, dans la vie réelle, des savants et artistes de toutes sortes (les frères James, Bergson, Einstein, Joyce, Proust, Delaunay, Duchamp, les futuristes, etc.) examinent eux aussi dans le plus grand détail ce qu’il en est du passé, de l’avenir, et surtout du présent, qui commence alors à prendre pas mal d’épaisseur.
Dans son étude sur le sujet et sur ces auteurs – The Culture of Time and Space (1880-1918) – Stephen Kern relève même qu’au début des années 1880, après de longues études sur la question, un certain Wilhelm Wundt avait réussi à établir la durée exacte d’un « bloc de présent »
that interval of time that can be experienced as an uninterrupted whole
Résultat : 5 secondes.
Un ambitieux (ou sceptique) de ses étudiants refit par la suite l’expérience, et la science fit un nouveau bond en avant: 12 secondes, avant que l’esprit humain prenne conscience qu’il passe à « autre chose ». Mais quoi?
Bel élan de positivisme fin de siècle en tout cas, dont on sait maintenant qu’il a peu duré.
Le ciel s’est assombri en une trentaine d’années.
Quand Thomas Mann formule son paradoxe, l’Europe connait une de ses crises de conscience les plus aiguës, et le soleil se couche déjà sur le « monde d’hier ». Le projet de la Montagne magique est né peu avant 1914, le roman fut écrit pendant le premier conflit mondial, et publié quelques années après (1924). L’écrivain connaît la fin de l’histoire et se doute que tout n’est pas terminé : les malades du Berghof attendent la mort comme l’Europe attend la guerre. Pour la première fois depuis l’ère des révolutions, la flèche du temps semble pousser les masses non plus vers un avenir radieux, mais à la catastrophe.
Curieuses, les années d’apprentissage du jeune Castorp. C’est parce qu’il n’y a que le néant au bout que l’attente s’étire dangereusement, rythmée par les coups de thermomètre, la couverture en poil de chameau, les repas dans la grande salle, les morts, les discussions sans fin.
Revers rétrospectif de l’expérience : si l’ennui ne laisse aucune trace dans le souvenir, si, comme l’écrit encore Thomas Mann
lorsqu’un jour est pareil à tous, ils ne forment tous qu’un seul jour
et puisque
dans une uniformité parfaite, la vie la plus longue serait ressentie comme très brève, et serait passée en un tournemain
alors c’est le signe que le cours des choses s’accélère, et c’est dans cette monotone immobilité que le petit monde du sanatorium galope vers sa fin.
Entre l’ennui et la guerre les hommes ont choisi la guerre, et on connaît la suite. Virginia Woolf écrivait dans son journal, un soir de septembre 1939 : « je note que la violence est bien la chose la plus inintéressante ».
Les temps ont changé, et avec eux les paradoxes. Le modèle dit « bref-bref » correspond au passage à une modernité avancée où l’innovation s’emballe, met sans cesse à disposition de nouveaux outils, de nouveaux objets, et propose toujours plus de nouveaux « contenus » ; riche période où des changements sociaux de plus en plus rapides, et à grande échelle, provoquent des crises toujours plus inédites les unes que les autres. Pendant ce temps, les dernières minutes de notre quotidien pacifié sont vidées par la multiplication des activités requérant un faible investissement intellectuel (input), mais procurant les satisfactions immédiates de plus en plus grandes (output).
Que vivons-nous, de plus en plus souvent (« même si, dit Harmut Rosa,
ce n’est pas toujours le cas »)?
Des moments intenses, en rafale; des instantanés déconnectés les uns des autres; des tranches de « vécu » décontextualisées, inaptes à former un terreau, donner sa forme à une vie, s’inscrire dans ce que Walter Benjamin appelait une « expérience ». Et que le mot « expérience » soit aujourd’hui utilisé à tort et à travers dans des réclames de toutes sortes ne change rien à l’affaire, au contraire. Le vide est notre seul horizon.
Comme à son habitude, Thomas Bernhard avait résumé tout cela mieux que tout le monde
Nous avons le vertige et nous avons froid. Nous avons cru qu’étant des hommes, nous allions perdre l’équilibre, mais nous n’avons pas perdu l’équilibre; et nous avons fait ce que nous pouvions pour ne pas mourir de froid.
(Mes prix littéraires, Gallimard, p.139, traduction par Daniel Mirsky)
C’était en 1965, l’année de Pierrot le fou, au milieu d’un discours lapidaire – littéralement – prononcé devant les représentants de la « Ville hanséatique libre de Brême », qu’on imagine médusés.
Thomas Bernhard, Extinction, p.113
Il y a des écrivains, avais-je dit à Gambetti, qui, lorsqu’il les lit pour la deuxième fois, enthousiasment encore beaucoup plus le lecteur que la première, il en est chaque fois ainsi pour moi avec Kafka. Kafka me reste en mémoire comme un grand écrivain, avais-je dit à Gambetti, mais en le relisant j’ai eu tout à fait l’impression d’en avoir lu un beaucoup plus grand encore. Peu d’écrivains deviennent plus importants, plus extraordinaires à la deuxième lecture, la plupart, nous les lisons pour la deuxième fois et nous avons honte de seulement les avoir lus une fois, c’est ce qui nous arrive avec des centaines d’écrivains, pas avec Kafka et pas avec les grands Russes, Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Lermontov, pas avec Proust, avec Flaubert, avec Sartre que je compte parmi les plus grands. Je ne trouve pas que ce soit la plus mauvaise méthode que de lire une deuxième fois les écrivains que nous avons lu une fois et qui nous ont impressionnés, en effet, ou bien ils sont encore beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, ou bien ils ne valent plus la peine qu’on en parle. Ainsi nous ne trimbalons pas dans notre tête, pendant toute notre vie, un énorme fatras de littérature qui finalement rend cette tête malade, avais-je dit à Gambetti sur le Pincio.
(Traduction Gilberte Lambrichs)
Thomas Bernhard encore et encore ses relectures, ici décrites comme le tamis qui permet d’isoler les textes qui comptent.
Il y a quelques jours j’ai assisté à la lecture, une relecture aussi, d’Extinction, au théâtre de la Madeleine. Serge Merlin parvient à donner des modulations – quand succèdent aux morceaux hurlés des mots dits à voix basse, à peine audibles ; quand l’élocution mécanique se mue en égarements lyriques – et des ouvertures – quand le lecteur s’arrête et écoute, dans le clair-obscur un peu plus obscur qui se fait sur scène, l’histoire dite par lui-même, Murau, du domaine de Wolfsegg – à ce bloc sans brèche, aux phrases droites et inflexibles.
Ces phrases il parvient à les gondoler, il en fait une partition. Elles s’animent dans sa bouche et sur la petite table, tout en laissant (autre miracle) le spectateur revenir ensuite au texte avec en tête une prosodie plus monocorde, pas moins inquiétante, pas moins burlesque, la sienne.
Thomas Bernhard avait ailleurs écrit ceci au sujet de ses textes et du théâtre :
Lorsqu’on ouvre un de mes livres, il en va toujours ainsi : il faut s’imaginer qu’on est au théâtre, avec la première page on lève un rideau, le titre apparaît, obscurité complète – et lentement, de ce fond, de cette obscurité, surgissent des mots qui se transforment en des processus de nature tant intérieure qu’extérieure, et qui, à raison même de leur caractère artificiel, deviennent tels avec une particulière netteté.
(Ténèbres, p.62 ; cité par Chantal Thomas dans Thomas Bernhard, le briseur de silence, p.35)
Jean Torrent et Serge Merlin ont tranché dans la masse pour tirer des cinq cents pages une heure vingt minutes à voix haute. L’auteur de Maîtres anciens, qui avait fait l’éloge de la lecture par fragments, n’aurait pas été mécontent. Mais on n’entend pas l’extrait sur les relectures.
Ce n’est pas pour rien que, depuis plus de trente ans, je vais au Musée d’art ancien. D’autres vont au café le matin et boivent deux ou trois verres de bière, moi je viens m’asseoir ici et je contemple le Tintoret. Une folie peut-être, pensez-vous, mais je ne puis faire autrement. (…) Ici, dans la salle Bordone, j’ai les meilleures possibilités de méditation et si j’ai par hasard ici, sur cette banquette, quelque chose à lire, par exemple mon cher Montaigne, ou mon Pascal qui m’est peut-être plus cher encore, ou mon Voltaire qui m’est encore beaucoup plus cher, comme vous voyez les écrivains qui me sont chers sont tous français, pas un seul allemand, je peux le faire ici de la manière la plus agréable.
Ne serait-il pas dès lors présomptueux de vous énumérer ici, en me prévalant d’une apparente objectivité ou sobriété, les pièces et sections principales d’une bibliothèque, ou de vous exposer sa genèse, voire son utilité pour l’écrivain ? En ce qui me concerne, en tout cas, je vise dans ce qui suit quelque chose de moins voilé, de plus tangible ; ce qui me tient à cœur, c’est de vous permettre un regard sur la relation d’un collectionneur à ses richesses, un regard sur l’acte de collectionner plutôt que sur une collection.
(Rivage poche « Petite bibliothèque », traduction de Philippe Ivernel)
Relecture annuelle du Discours de la méthode. On y sent toujours un vent d’avenir.
De manière moins compulsive, plus distanciée et raisonnable que Reger, plus proche en cela d’Hédi Kaddour (Descartes contre Pascal), je reviens aux mêmes textes, souvent au printemps. A la fiction spatiale de l’île déserte je préfère la métaphore temporelle des saisons qui isole plus précieusement les livres qui comptent dans l’unité d’un temps que dans celle d’un lieu (mais des lectures et des lieux, j’ai déjà parlé ici).
C’est aussi plus réaliste. L’île déserte est une utopie, pas seulement parce qu’aujourd’hui le globe est toujours mieux connu, plus relié et moins désert, mais parce que le dégoût naitrait immanquablement de la relecture en circuit fermé des mêmes ouvrages, sans la respiration que procure la découverte des autres. Ceux qui tiennent à cœur gagnent à être quelque peu noyés dans un flux de lectures plus ou moins heureuses d’où ils émergent plus facilement.
Je déballe ma bibliothèque, comme dirait l’autre, mais la toute petite, celle des éternels retours, huit livres au total:
Reger revoyant encore et encore le Portrait de l’homme à la barbe blanche dans la salle Bordone du Musée d’Art Ancien de Vienne, vu par Irrsigler, vus par Atzbacher dans Maîtres anciens.
 Sebald : surtout les Anneaux de Saturne, et un petit texte qui me revient de plus en plus entre les mains, sa promenade au cimetière de Piana qui donne son titre au recueil posthume Campo Santo
Sebald : surtout les Anneaux de Saturne, et un petit texte qui me revient de plus en plus entre les mains, sa promenade au cimetière de Piana qui donne son titre au recueil posthume Campo Santo , une anabase. Après avoir plongé dans l’eau de la Méditerranée le narrateur remonte interroger les tombes à flanc de versant et en vient à méditer sur le combat inégal, horizontal celui-là, que se livrent les morts et les vivants depuis que l’urbanisation a gagné des portions toujours plus larges des terres habitées.
, une anabase. Après avoir plongé dans l’eau de la Méditerranée le narrateur remonte interroger les tombes à flanc de versant et en vient à méditer sur le combat inégal, horizontal celui-là, que se livrent les morts et les vivants depuis que l’urbanisation a gagné des portions toujours plus larges des terres habitées.
Où les mettre, les morts de Buenos Aires et de Sao Paulo, de Mexico City, de Lagos et du Caire, de Tokyo, de Shanghai et de Bombay?
La vraie Vie de Sebastian Knight de Nabokov, le premier de ses textes écrits en anglais. Il est peut-être moins virtuose que les autres, mais le ton amusé, faussement léger de l’enquête m’a toujours séduit.  Je relis aussi souvent Autre Rivages, où je trouve une atmosphère comparable. Les deux forment un diptyque à mes yeux.
Je relis aussi souvent Autre Rivages, où je trouve une atmosphère comparable. Les deux forment un diptyque à mes yeux.
Celui qui m’est sans doute le plus cher : le Jardin des plantes de Claude Simon (je le relis en ce moment), son temps retrouvé. Il y a des rapprochements étonnants à faire avec les Anneaux de Saturne, écrit avant, et j’en ferai bientôt. Au revers de la couverture de son exemplaire Sebald a ébauché la première chronologie d’Austerlitz.
Chaque année une année des Carnets de notes de Bergounioux.
La nouvelle de William Gass, Au cœur du cœur de ce pays, last but not least.
Il y en a qui sont revenus moins souvent – tous les deux, trois, quatre ans :
La Montagne magique
Danube, et Microcosmes de Claudio Magris
Le Joueur, de Dostoïevski, que je relis juste avant ou juste après un Eté à Baden Baden, de Leonid Tsipkyn, un superbe récit sur les pas du grand Fiodor, l’œuvre unique d’un petit fonctionnaire soviétique mort au début des années 80.
Le premier tome (ou partie) de l’Homme sans qualité (voir ici pour quelques réflexions sur ce travers que je partage avec beaucoup de lecteurs). Deux petits livres complémentaires, d’un grand musilien : Prodiges et vertiges de l’analogie et Le philosophe chez les autophages, de Jacques Bouveresse. Même discipline intellectuelle, même ironie, même vertu, le geste d’essuyer régulièrement ses verres de lunette.
La Recherche, je ne la relis pas, pour la bonne raison que je ne l’ai pas encore lue en entier, et ceci pour une autre bonne raison : je relis plus que de raisonnable la deuxième partie d’A l’ombre des jeunes filles en fleur.
Certains livres, longtemps revisités, ont peu à peu disparu: les grands romans de Faulkner. D’autres reviennent : grand plaisir, si je puis dire, à la Nausée, après quelques années au loin. L’épreuve peut être cruelle: le Testament à l’anglaise de Coe, le Dalhia noir d’Ellroy n’ont pas tenu les dix ou quinze ans passés depuis le premier enthousiasme.
Des raisons très diverses et très communes expliquent sans doute ma propension à la relecture, mais je préfère ici rechercher des motifs plus littéraires. D’abord ce qui pourrait être perçu comme des insuffisances. Contrairement à Nabokov, j’ai en effet beaucoup de mal à me représenter précisément la scène décrite, à m’imaginer Gregor en gros scarabée plutôt qu’en cafard (il serait plutôt un mélange des deux, avec, selon les gros plans du texte, telle ou telle partie du corps d’un insecte, telle autre d’un autre insecte), à me dessiner clairement l’appartement de la famille Samsa.
Je lis un peu flou, et je ne m’inquiète pas vraiment de rendre ma lecture plus claire ou plus fidèle à la lettre. Une proie idéale pour Flaubert qui, malgré les méticuleuses recherches qu’il s’imposait, souhaitait justement créer une image brouillée, propice à l’imagination.
Le manque de disposition à identifier les détails exacts, les défauts de concentration dans le suivi des intrigues, les erreurs souvent énormes quant aux relations entre les personnages (leur nom même m’échappe souvent, et je suis impressionné quand je lis ensuite le résumé limpide que font les critiques de certains gros et complexes récits), tout cela permet aussi de ne garder que des impressions, des souvenirs de « grands moments », quitte à mal les placer dans l’économie générale de l’œuvre.  Après bien des relectures des textes Sebald il m’est difficile de dire si telle traversée de banlieue se trouve dans les Anneaux ou dans les Emigrants, telle remarque sur les feux de forêt dans un court texte de Campo Santo ou dans Austerlitz (en fait les deux, mais aussi dans les Anneaux), etc.
Après bien des relectures des textes Sebald il m’est difficile de dire si telle traversée de banlieue se trouve dans les Anneaux ou dans les Emigrants, telle remarque sur les feux de forêt dans un court texte de Campo Santo ou dans Austerlitz (en fait les deux, mais aussi dans les Anneaux), etc.
Il y a enfin une parenté entre ces œuvres, qui correspondent à ce type de lecture impressionniste, puisque la plupart de celles que j’ai citées, quand il ne s’agit pas de journaux, manquent justement de cette ligne droite, de cette colonne vertébrale bien articulée (les lopins à la Montaigne du jardin mémoriel de Claude Simon).
Ou plutôt elles n’en manquent pas mais leurs auteurs (les auteurs que j’aime) l’ont recouverte d’une telle épaisseur de digressions, de rêveries, de fausses pistes, que je la perds assez vite de vue tout en me laissant inconsciemment porté par elle.
Mais il n’y a naturellement aucune consolation pour la perte de l’être qui vous a été le plus proche pendant toute la vie. C’est bien aussi une méthode, a-t-il dit hier, tandis qu’à présent, donc un jour après, je le regardais de côté et, derrière lui, Irrsigler, qui avait piqué une tête dans la salle Sebastiano sans me remarquer, donc, tandis que j’observais toujours Reger qui contemplait toujours l’homme à la barbe blanche de Tintoret, c’est bien aussi une méthode, a-t-il dit, que de tout transformer en caricature. Un grand tableau important, a-t-il dit, nous ne le supportons que lorsque nous l’avons transformé en caricature, un grand homme, une soi-disant personnalité importante, nous ne tolérons pas l’un en tant que grand homme, l’autre en tant que personnalité importante, a-t-il dit, nous devons les caricaturer.
Jusqu’ici, dans chacun de ces tableaux, soi-disant chefs-d’œuvre, j’ai trouvé un défaut rédhibitoire, j’ai trouvé et dévoilé l’échec de sn créateur. Depuis plus de trente ans, ce calcul infâme, comme vous pourriez le penser, s’est révélé juste. Aucun de ces chefs-d’œuvre mondialement connus, peu importe leur auteur, n’est en vérité un tout et parfait. Cela me rassure, a-t-il dit. Cela me rend heureux. C’est seulement lorsque nous nous sommes rendus compte, à chaque fois, que le tout et la perfection n’existent pas, que nous avons la possibilité de continuer à vivre.
(Folio, traduction Gilberte Lambrichs)
Entre le lecteur et les formules impitoyables du critique musical Reger il y a les « a-t-il dit » du narrateur Atzbacher qui le regarde, assis dans la salle Bordone du Musée d’Art ancien de Vienne, regardant le tableau du Tintoret ; qui le regarde aussi regardé par le gardien du musée Irrsigler. Et même Atzbacher, à la fin perd de sa consistance, en une dernière pirouette, regardé par un autre encore. C’est une méthode de sape à l’infini, auquel n’échappe donc pas la critique des chefs d’œuvre elle-même, ou plutôt la critique de la transformation des œuvres d’art en chefs-d’œuvre, leur mise en musée, leur panthéonisation, leur canonisation, le trop grand respect qui les entoure et qui empêche de les voir, les « sublime », les « formidable », ce que le texte de Bernhard décape en commençant par le point faible, un détail, les inévitables ratés qui les rendent uniques. Il ne nous dit pas si c’est une force ou une faiblesse, il en fait simplement son livre, ce qui est déjà un début de réponse.
J’ai été étonné de retrouver en très peu de temps plusieurs occurrences de cette question. Parfois, souvent même, il semble que tout ce qui tombe sous les yeux participe d’une seule et même discussion entre des textes qui n’ont pourtant rien à voir, composés à des années et des kilomètres de distance par des gens qui n’ont aucunement en tête les idées de l’autre.
Peu après avoir achevé Maîtres anciens, en feuilletant à nouveau (à la Reger) le Journal d’Hédi Kaddour, j’ai lu ce passage :
Colette. La Femme cachée. Mégalo : je me surprends à vouloir corriger du Colette :
« Elle excelle à organise(r) elle-même son esclavage pour le sadique plaisir de pleurnicher d’humiliation, après.
Ratures faites, on a changé de lecteur. Ce serait un lecteur achevant lui-même le sens, se disant tout seul que c’est un plaisir « sadique » et même sado-maso. Un lecteur qui construirait aussi les étapes du scénario sans l’aide d’ « après ».
Colette savait. Mais elle n’a pas fait (voulu faire) passer la hache. Une question de confort ? de vitesse (l’œil filant paradoxalement plus vite sur un parcours un peu balisé) ?
Mes « corrections » donnent une autre Colette, c’est-à-dire personne, une nouvelle phrase qui court plus lentement dans la tête, en tâche d’arrière-plan. Elle n’aura jamais d’existence réelle, ça n’est qu’un fantôme, mais un fantôme exigeant, qui informe toutes les phrases qu’on écrira ensuite soi-même. Une barre, haut placée : la folie de faire mieux que Colette.
C’est aussi un moyen de continuer à lire. Moyen pionesque, honteux. Je ne m’en suis accommodé que le jour où j’ai lu chez Pessoa (Le livre de l’intranquillité) :
« Je ne peux pas lire, parce que mon sens critique suraigu n’aperçoit que défauts, imperfections, améliorations possibles. »
(Les Pierres qui montent, p.256-257)
Et l’auteur dresse la liste de ces lecteurs « pionesques » (Stendhal, Flaubert, Jünger), qui font de la correction des maîtres une préparation à l’art.
Kaddour n’est pas aussi catégorique et mégalomane que ces derniers, et carrément moins que Bernhard (ou Reger). Il veut « sauver » Colette en lisant dans sa maladresse une élégance. Cependant il y a cette belle expression « fantôme exigeant » qui me fait penser à Thomas Bernhard, maugréant et riant dans sa maison loin de tout, entouré de ses fantômes à lui.
Enfin il y a quelques heures, dans le train, ces mots en forme d’encouragement au futur lecteur de la Recherche, par Antoine Compagnon:
Peut-être est-ce la première chose dont il faut se convaincre pour pouvoir se plonger dans Proust : cette œuvre n’est pas parfaite, elle est ce qu’elle est, mais elle aurait pu être autre chose. Le livre que nous tenons entre les mains est contingent, inachevé : il a été interrompu par l’imprimeur pour les premiers volumes, par la mort de l’auteur pour les derniers. Il a été, pour ainsi dire, bâclé. Si ce roman peut, doit être lu vite – il sera toujours temps d’y revenir -, c’est aussi que, à l’encontre d’une idée reçue qui effraie aussi, il a été conçu dans la hâte, entre 1909 et 1912 pour la première version à peu près au point à la veille de la Grande Guerre, entre 1915 et 1916, pour la seconde version introduisant Albertine, c’est-à-dire en très peu de temps. Au-delà, Proust relit, révise, remembre, raccorde indéfiniment. Montaigne, lui, a mis vingt ans à écrire les Essais, de 1572 à sa mort en 1592, soit moins de soixante pages par an ? Proust lui, fonçait.
(« La Recherche à hauteur d’homme », Le Magazine littéraire, avril 2010)
La correction est belle quand elle se fait paperolle. Quant à Montaigne, c’est un des rares que (Reger) Bernhard n’écorne jamais, avec Pascal, et Voltaire.