Marcel Proust, le Temps retrouvé:
Mais peut-être Albertine avait-elle voulu me dire cela pour avoir l’air plus expérimentée qu’elle n’était et pour m’éblouir à Paris du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec de celui de sa vertu. Et tout simplement quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes, pour ne pas avoir l’air de ne pas savoir ce que c’était, comme dans une conversation on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu’on ne sache pas ce que c’est.
(p.14, édition Folio)
Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk, « Mémoire involontaire et détail mnémotechnique » :
Dans ce contexte, la théorie proustienne de la mémoire et de la lecture apparaît comme un moyen pour Czapski de maintenir vivant le souvenir des camps et des disparus, menacés d’oubli par la grande Histoire. Elle a pu contribuer à ce qu’il développe une contre-histoire ou une micro-histoire, basée sur le détail et la recherche des indices (…)
(Ecrire l’histoire, N°3, printemps 2009)
Cette superbe revue a une diffusion si confidentielle qu’il m’a fallu revenir chez le libraire de mes années de formation pour enfin mettre la main sur le premier des deux volumes consacrés au Détail. Après une réponse circonstanciée à la question qui ouvre le numéro : « Jeanne d’Arc a-t-elle menti ?», à côté d’un article sur le « bouton de culotte » dans la Semaine sainte d’Aragon, juste avant une lecture étonnante d’Allemagne neuf zéro de Godard (« L’histoire (s’) en balance », de Suzanne Liandrat-Guigues), et parmi bien d’autres analyses toujours rigoureuses et originales, il y a cette lumineuse étude intitulée « Mémoire involontaire et détail mnémotechnique. Czapski lecteur de Proust, camp de Griazowietz, URSS, 1941 ».
Elle n’est pas sans rapport avec celle que Catherine Coquio a consacrée à Raul Hilberg et Saul Friedlander dans le second volet paru à l’automne dernier. Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk se demandent comment et pourquoi le peintre polonais Joseph Czapski, alors qu’il était prisonnier de l’armée rouge, a pu donner en 1941 une série de conférence sur La Recherche du Temps perdu à ses co-détenus sans le recours du moindre livre.
Le point de départ de l’article est une page des notes retrouvées et publiées par la suite dans son journal Proust contre la déchéance. Moins un texte qu’un tableau.
Juste sous « Du côté de chez Swann », il y a deux mots entre lesquels convergent toutes les lignes.
De l’expression « cloison étanche » semble germer et rayonner l’ensemble de la Recherche remémorée par Czapski. Pourquoi ces mots? On attendait « madeleine », mais la mémoire de Czapski l’a trahie en « brioche ».
Du grand intérêt de l’article : à cette question simple, posée sur le mode de l’énigme, il sera donné une réponse complexe, car s’il est vite relevé que dans la cathédrale proustienne le terme « cloison » appelle souvent des épisodes de mémoire involontaire (en particulier les réminiscences touchant à la mort de la grand-mère), il apparaît que la formule n’avait pas pour Czapski cette unique valeur mnémotechnique.
Les deux auteurs font mieux que se livrer à un décryptage savant et univoque de la « formule » générique d’où sont nées les conférences. Ils parviennent, en dévoilant sa polysémie, à la faire « lever », lui faisant rejouer ce rôle de ferment qu’elle avait eu dans la baraque de Griazowietz.
« Cloison étanche », d’abord celle qui protège l’œuvre de Proust, que sa publication retardée par le conflit a comme « mise sous serre », offrant au projet de nouveaux bourgeonnements et les conditions d’une croissance imprévue.
Je relève un passage à ce sujet dans le Jardin des plantes de Claude Simon, quelques pages avant le récit de son évasion du camp de prisonnier où la débâcle de 1940, sur l’autre front, l’avait lui-même mené.
Le Jardin des plantes:
Au mois d’octobre 1916, Proust écrit à Gaston Gallimard : « Et puisque ce mot de guerre est venu « sous ma plume », je crois (mais d’ailleurs c’est sans intérêt pratique, puisque nous ne le pouvons pas) que j’ai eu tort de vouloir attendre la fin de la guerre pour paraître (…). Mais (mes raisons) maintenant que j’y ai pensé (et encore une fois c’est toujours théorique) sont qu’en ce moment où (pas moi mais presque tout le monde) on s’est habitué à la guerre, on ne lit guère que le communiqué et encore, on aimerait quelque chose d’autre, on pourrait s’intéresser à une longue œuvre. Après la guerre, la Paix, la victoire, seront des choses nouvelles, savoureuses, on y pensera, plutôt qu’à lire. Et alors la guerre elle-même déjà rétrospective, deviendra l’objet d’un intérêt d’imagination qu’elle n’excitait pas comme réalité quotidienne et d’un progrès insensible. »
(p.1000-1001, édition Pléiade)
Et il commente ainsi le choix d’une autre des citations de Proust utilisées dans le Jardin :
De plus encore, il y a parfois des chevauchements, des sortes d’échos. Par exemple, dans le Jardin des plantes, après un compte-rendu militaire des combats sur la frontière belge où sont énumérés le nom des blockhaus (noms de lieux-dits parfois pittoresques), au paragraphe suivant, l’un des personnages de Proust s’exclame : « Comme ces noms sont jolis ! » à propos cette fois de noms de villages normands dont on ne peut s’empêcher de penser que, peut-être, pour les soldats américains ou anglais, en 1944, ils ont aussi été synonymes d’enfers.
(Entrentien paru dans L’Humanité, 13 mars 1998, cité dans une note (p.1510) par Alastair B. Duncan, qui a réalisé l’édition des Œuvres dans la Pléiade)
Cinquante ans après, on repère chez Claude Simon un semblable usage de la Recherche en contrepoint esthétique et mémoriel de la description des souffrances de guerre – contrepoint qui est aussi un des modes privilégiés de la mémoire proustienne – auquel l’écrivain français ajoute une touche de dérision, absente chez le peintre polonais. L’extrait cité dans le Jardin des plantes redouble encore le caractère ironique de ces rapprochements (ce dont Czapski était parfaitement conscient), puisqu’il apparaît que Proust lui-même regrettait amèrement ces retards sans s’apercevoir des prolongements fructueux qu’ils pouvaient provoquer.
Pour le prisonnier la métaphore de la serre était d’autant plus douloureuse qu’il avait vu sauter une à une toutes les parois de protection depuis la double invasion de la Pologne en septembre 1939, et qu’il craignait (à juste titre) pour ses propres œuvres. De ce cocon offert à l’artiste, il n’était plus question pendant le conflit et encore moins après. On ne saurait être plus clair sur la désillusion que l’épreuve à provoquée :
Joseph Czapski, Souvenirs de Starobiesk:
Les cloisons étanches qui protégeaient la croissance de l’œuvre de Proust pendant la dernière guerre ont été rasées.
(Editions Noir sur Blanc, cité par Guiillaume Perrier et Agnieska Zuk)
D’ailleurs Czapski inverse le sens même de sa formule : la cloison isole et protège, mais elle rappelle en même temps au peintre la claustration forcée de Proust, écho de son propre enfermement. A la douleur de la maladie répond celle de la privation de liberté, et la chambre confinée et surchauffée de l’écrivain, qui fut son tombeau, devient l’image renversée des baraquements glacés du camp, d’où on ne sort que par miracle.
Les auteurs de l’article repèrent enfin un troisième usage, mémoriel, des mots de Proust, qui permettent à Czapski de rattacher l’œuvre remémorée au contexte de sa remémoration, faisant ainsi naitre, comme par anticipation, une sorte de « mémoire au carré ». En l’occurrence « cloison étanche » rappelle non seulement le contenu de la Recherche mais aussi dans quel endroit et à quel moment il s’est souvenu de la Recherche. Lecture sans livre qui, comme dans la théorie proustienne, permet de garder sensible le lieu même de la lecture, que ce dernier soit le salon confortable de l’enfance, un jardin ombragé, ou un camp de prisonniers.
Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk n’y font pas allusion, mais on sait par ailleurs que beaucoup d’autres écrivains ont fait l’expérience de la dimension salvatrice (mais toujours ambiguë) d’une mémoire de la littérature. Dans bien des écrits publiés ensuite par les rescapés, cette mémoire est devenue une ressource poétique nourrissant tout ou partie de l’œuvre. Je pense à Primo Levi « lecteur » de Dante à Auschwitz, Jorge Semprun de Goethe, Heine ou Valéry au camp de Buchenwald, Evguenia Gunizburg et Pouchkine, Chalamov et Dante, encore, à Magadan.
Se souvenir d’un mot, d’un vers, des traits saillants d’une pensée, c’est sortir un moment du camp et se rappeler contre toute évidence l’existence et l’expérience du « beau » et du « bien », même si c’est pour mettre à bonne distance la « culture » ; c’est en même temps y revenir en utilisant l’œuvre comme métaphore et ressource d’intelligibilité au milieu de ce qui n’a pas de sens et ainsi « baliser l’espace », comme le dit Luba Jurgenson (1); c’est enfin témoigner « d’ores et déjà » (Jurgenson), et garder l’espoir que rien ne sera oublié après et que ce qui peut passer pour un détail ou une occupation bien inutile deviendra la pierre de touche du témoignage, contre toutes les tentatives ou les tentations de l’oubli.
A cette aune le choix de l’expression matricielle apparaît d’autant moins hasardeux, comme le souligne l’article, que l’une des deux occurrences de l’expression dans la Recherche (celle que j’ai reprise en exergue) est associée de près à Tobolsk, le lieu où furent retenus prisonnier puis exécutés le tsar et sa famille, et que la « cloison étanche » sert à séparer dans l’esprit du narrateur, ceux qui « en sont » des autres, Albertine de ses amies homosexuelles.
Une « cloison étanche » sépare ceux qui veulent savoir de ceux qui ignorent.
Les dernières lignes de l’article rappellent qu’à l’aide de cette infime formule, et avant de mener lui-même l’enquête, Czapski combattait le silence et le mensonge enveloppant l’exécution par le NKVD de plus de vingt mille prisonniers polonais dans la forêt de Katyn et sur d’autres sites aux confins de l’Ukraine et de la Russie, entre avril et mai 1940. Déplacé de camp en camp de plus en plus à l’est, il échappa au massacre sans jamais vraiment comprendre pourquoi.
Note:
(1) Luba Jurgenson, L’expérience concentrationnaire est-elle indicible?, Editions du Rocher. En particulier la partie 2 du chapitre 3, intitulée, d’après Primo Levi, « Le chant d’Ulysse ».
Notes sur les images, dans l’ordre d’apparition:
Couverture du numéro 3 de la revue Ecrire l’histoire, l’illustration est d’Henri Cueco, d’après l’Ex-voto de Philippe de Champaigne, 1995-1996
Détails d’une double page reproduite dans l’article cité, elle même reprise du Journal de Czapski publié par les éditions Noir sur Blanc.
La photographie de la serre du jardin des plantes de Paris est de Danielle Grekoff, on peut la retrouver sur son site, à côté d’autres beaux clichés.
Philippe de Champaigne, Ex-voto, 1662, Musée du Louvre
Photographie des Romanov en captivité à Tobolsk (source inconnue)
Détail de la carte fournie par les auteurs de l’article cité.
Dernière chose: Les deux numéros annuels de la revue paraissent au printemps puis à l’automne, aux éditions Gaussen. Les prochains, dont le premier devrait paraitre sous peu, auront pour objet « la morale ».










 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 























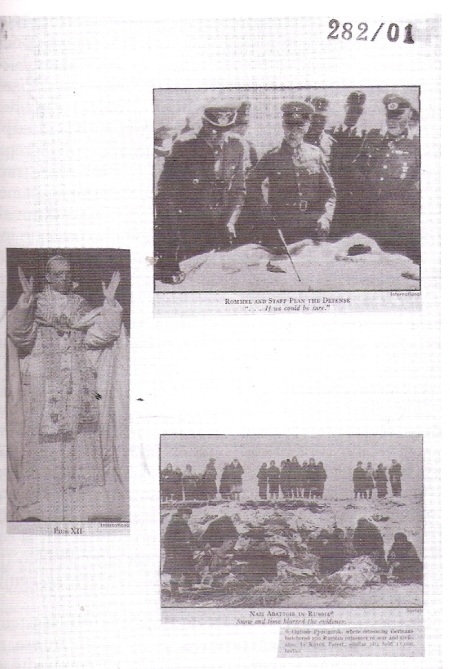
 Après avoir identifié ce qu’ils devaient à « la position de l’exilé » de Brecht, et mis en lumière la « disposition aux choses » de ce dernier, faite d’ironie grinçante et d’attention aux victimes, la magistrale analyse qu’en donne Georges Didi-Huberman dans Quand les images prennent position se tourne vers la « dysposition des choses » à l’oeuvre dans les deux livres, dans une troisième partie qui est un éloge circonstancié du montage. On comprend qu’aux yeux du philosophe français l’artiste qui sait en jouer semble jouir d’un privilège visionnaire que n’a pas l’historien.
Après avoir identifié ce qu’ils devaient à « la position de l’exilé » de Brecht, et mis en lumière la « disposition aux choses » de ce dernier, faite d’ironie grinçante et d’attention aux victimes, la magistrale analyse qu’en donne Georges Didi-Huberman dans Quand les images prennent position se tourne vers la « dysposition des choses » à l’oeuvre dans les deux livres, dans une troisième partie qui est un éloge circonstancié du montage. On comprend qu’aux yeux du philosophe français l’artiste qui sait en jouer semble jouir d’un privilège visionnaire que n’a pas l’historien.











