
Ça débute comme ça:
« Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards ils mesuraient en moyenne 1m73 et si on avait pu les ranger bout à bout plante des pieds contre crâne ils auraient mesuré 38 km ». (p.7) (traduction Marianne Canavaggio)
De la guerre, et de la statistique, mises bout à bout. Un XXème siècle de bruit, de fureur et de chiffres. En marge, comme de petits aides-mémoire à l’usage de l’écolier:
« Les Anglais inventèrent les chars »
« Marches militaires »
« Les Allemands inventèrent le gaz »
mais aussi, plus loin, entre autres
« Les poupées à zizi »
« La transformation du sujet pathologique »
« La guerre n’est jamais terminée »
Beaucoup d’innovations, peu de progrès.

Comme d’autres avant lui l’auteur, né en 1957 à Prague, démonte le XXème siècle en s’affranchissant de toute chronologie. La première guerre mondiale, la guerre tout court, apparait comme un cancer originel dont on ne finit pas de retrouver les métastases ailleurs: génocides, massacres, eugénisme. La rationalité occidentale (Europeana), accouplée aux idéologies nationaliste puis totalitaires, accouche de monstruosités. Les faits sont connus. Le style est efficace et renouvelle le genre: courts paragraphes, juxtaposition de notations reliées uniquement par des « et » qui défient la causalité, ton faussement naïf. On sait (Didi-Huberman l’a récemment montré à propos de Brecht, Godard en est l’un des maîtres) quelle puissance peut avoir ce genre de montage qui rapproche parfois mieux que le discours historique les ordres de réalité éloignés, désigne des victimes et des bourreaux insoupçonnés, offrant ainsi une pédagogie et une morale alternatives. On devine à quels dangers peut exposer le fait de se passer de logique pour recourir aux séductions du collage et sombrer dans la complaisance de l’histoire « dite par un idiot ». Il y a bien une éthique du montage, et ici, comme chez Brecht, elle est respectée.
Patrik Ourednik n’oublie pas qu’il arrive après la bataille (le livre a été publié en 2001). Il sait que l’histoire du XXème a déjà été maintes fois écrite par des historiens professionnels, que des sociologues, politologues, philosophes, économistes l’ont analysée, disséquée, interprétée.
p.8
« Certains historiens ont dit plus tard que le vingtième siècle n’avait en fait commencé qu’en 1914 quand la guerre avait éclaté parce que c’était la première guerre de l’histoire où il y avait autant de pays engagés et autant de morts et où les dirigeables et les aéroplanes bombardaient l’arrière et les villes et les populations civiles et les sous-marins coulaient les bateaux et les canons tiraient par-dessus les lignes à douze kilomètres de distance ».
Son histoire est aussi une historiographie, une mise en scène de l’histoire écrite et s’écrivant, y compris la plus novatrice, qui a pris la mémoire pour objet. Les références savantes ne sont jamais citées mais impeccablement résumées (on reconnaîtra ici Eric Hobsbawm, ailleurs Max Weber. Adorno peut-être? Beaucoup m’ont échappé). Pourtant leur usage, sans être irrespectueux, est loin d’être servile, tant les liens (chrono)logiques sont rompus, les plans économiques, sociaux, politiques juxtaposés sans aucune précaution universitaire. Les événements sont mélangés comme dans le cerveau hypermnésique d’un historien malade. On peut pourtant se risquer à identifier dans ces aplats théoriques, une sympathie pour certains auteurs. Ici, George Mosse ? (1):
p.57-58
« Et certains historiens disaient que la construction de monuments était contestable car conserver la mémoire d’un événement ne garantissait en rien qu’il ne se reproduise pas et ils citaient de conservation de la mémoire qui avaient conduit à de nouveaux conflits et à de nouvelles guerres. »
L’ensemble tient de l’essai, du pamphlet sur la ruine des idéaux, du récit humoristique singeant le manuel scolaire et la récitation sage, du poème incantatoire. Un ABC de la guerre et du totalitarisme. Comme dans Instant propice, 1855 (2), l’écrivain tchèque jubile à dérégler le bon ordonnancement du débat idéologique, pour en montrer le ridicule, la vanité, mais aussi la puissance, l’inquiétant magnétisme.
L’homme est-il encore le personnage principal de cette histoire, réduit qu’il est à ses mesures? Peut-être pas, mais la mise en question des lendemains qui chantent ne pousse par pour autant Ourednik dans les bras d’un postmodernisme facile, ou pire, de la « Fin de l’histoire » (qui a droit à la dernière indication en marge). Tout reste à faire.
Terminant, logiquement, sur la thèse de Fukuyama:
p.151
« Mais beaucoup de gens ne connaissaient pas cette théorie et continuaient à faire de l’histoire comme si de rien n’était. »

Est-ce une promesse, pour celui qui a fui la Tchécoslovaquie communiste, qui a traduit et fait publié en français des extraits du journal du dissident Jan Zabrana (3) ? Refaire de l’histoire autrement, pour lui, c’est la réécrire sans illusion. C’est instaurer une inquiétante étrangeté dans les faits, privilège de la littérature sur le discours savant. Redonner aux choses leur part de confusion, d’ambiguïté, de ridicule: triomphe (?) de l’art qui sait associer utopie et désenchantement.
Le chemin est court qui mène à Claudio Magris, autre produit merveilleux de la Mitteleuropa. Je lis son évocation de Notre maîtresse la mort, œuvre de Giorgio Voghera, habitué du café San Marco de Trieste:
Microcosmes, p.34:
« Ces hospitalisations et ces décès, qui se succèdent de chapitre en chapitre, finissent même par avoir un effet comique involontaire, comme toute série exagérée de malheurs, qui au début suscite la compassion mais, au-delà d’une certaine limite, l’hilarité de celui qui écoute. Ce caractère irrésistiblement comique des désastres met à nu l’extrême faiblesse de la condition humaine, qui sous un poids excessif de misère se voit dépouillée de sa dignité, exposée au ridicule, réduite à n’être qu’un rebut.
En un certain sens, Voghera réécrit le Livre de Job mais en se plaçant du côté, non pas de Job, mais de ses fils et filles aînées qui, durant les épreuves auxquelles il est soumis, périssent sous les ruines de la maison, abattus comme les troupeaux par le vent du désert, et qui lorsque tout s’arrange à la fin sont remplacés comme les troupeaux et les chameaux, sans que leur souvenir vienne troubler la fin de la vie heureuse de leur père ».

Que fait Ourednik, sinon rappeler l’existence de ces enfants morts à notre bon souvenir?
Note:
(1) George Mosse a notamment écrit Fallen Soldiers (1991), son étude la plus connue en France, où il montre comment, entre autres choses, les monuments aux morts ont contribué à « brutaliser » les sociétés européennes, en particulier dans l’entre deux guerres. Son livre a été traduit en français sous le titre De la Grande Guerre au totalitarisme
(2) Autre livre de sa plume paru en français, toujours aux indispensables éditions Allia. Il évoque le destin d’une utopie anarchiste européenne dans le Brésil de 1855. De grands moments de dialogues essentiels et insensés.
(3) Même éditeur, une sélection (un peu frustrante) de ce monument a été publiée sous le titre Toute une vie.
Photographies: Florilège de la Sovfoto, l’organe de propagande par l’image de l’empire soviétique: 1. Non identifiée, visible ici, 2. Le détail, ici non retouché, de la célèbre photographie de Khaldei. Le soldat a encore une montre à son bras droit, sans doute gagnée au pillage de Berlin (1945). 3.Dmitri Baltermans, l' »oeil de la nation ». Désolation, 1941.






 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 

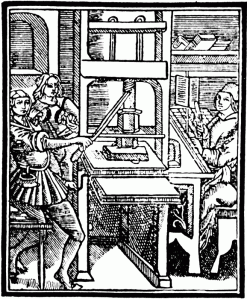










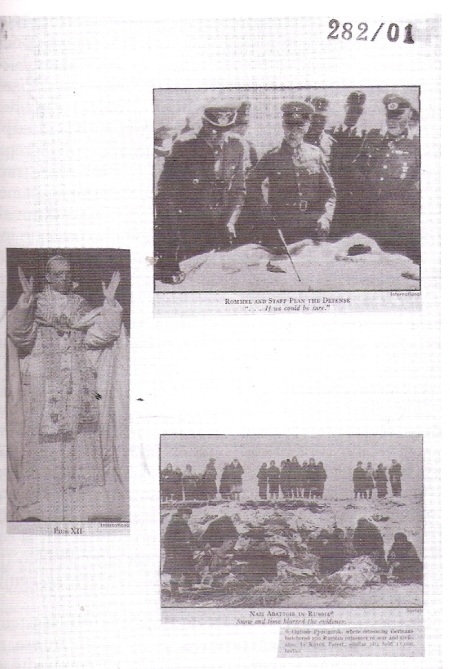
 Après avoir identifié ce qu’ils devaient à « la position de l’exilé » de Brecht, et mis en lumière la « disposition aux choses » de ce dernier, faite d’ironie grinçante et d’attention aux victimes, la magistrale analyse qu’en donne Georges Didi-Huberman dans Quand les images prennent position se tourne vers la « dysposition des choses » à l’oeuvre dans les deux livres, dans une troisième partie qui est un éloge circonstancié du montage. On comprend qu’aux yeux du philosophe français l’artiste qui sait en jouer semble jouir d’un privilège visionnaire que n’a pas l’historien.
Après avoir identifié ce qu’ils devaient à « la position de l’exilé » de Brecht, et mis en lumière la « disposition aux choses » de ce dernier, faite d’ironie grinçante et d’attention aux victimes, la magistrale analyse qu’en donne Georges Didi-Huberman dans Quand les images prennent position se tourne vers la « dysposition des choses » à l’oeuvre dans les deux livres, dans une troisième partie qui est un éloge circonstancié du montage. On comprend qu’aux yeux du philosophe français l’artiste qui sait en jouer semble jouir d’un privilège visionnaire que n’a pas l’historien.






















