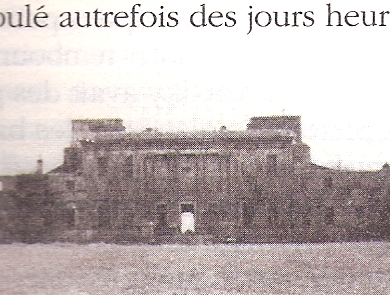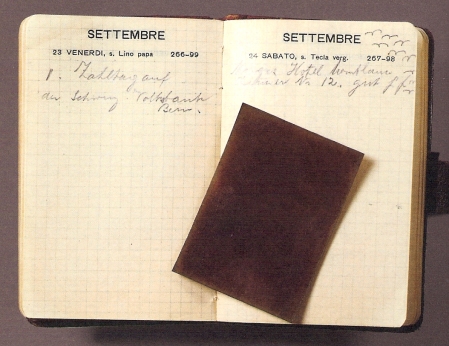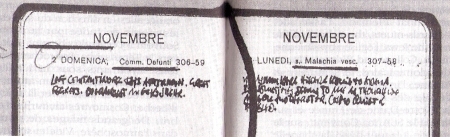W. G. Sebald, Austerlitz, p.15
Nos conversations d’Anvers, comme il les a parfois appelées ultérieurement, eurent trait, au premier chef, à l’histoire de l’architecture.
Jean Clair, Le voyageur égoïste, p.222
J’aimais la gare d’Anvers plus que toute autre.
Une rencontre rêvée : celle du narrateur d’Austerlitz (ou Jacques Austerlitz lui-même) avec Jean Clair, autre historien d’art, qui pour des motifs plus voluptueux
On sait combien les gares ont depuis toujours partie liée avec certains plaisirs.
avait pris l’habitude de se rendre à Anvers au cours des années soixante et avait été lui aussi frappé par les dimensions et l’allure peu communes de la Centraal Station, dont il perçoit très vite des reflets
dans ma mémoire, le souvenir de la gare est inséparable d’un autre bâtiment
dans d’autres lieux proches, un peu comme la gare, dans le récit de Sebald, vient se confondre dans l’esprit du narrateur avec le Nocturama du zoo voisin, et ses animaux reclus
c’était sans doute des chauve-souris et des gerboises venues d’Egypte ou du désert de Gobi, des hérissons, des chouettes et des grands-ducs de nos contrées, des sarigues australiennes, martres des bois, loirs et makis sautant de branche en branche
avec les voyageurs en attente dans la salle des pas perdus
derniers représentants d’un peuple de taille réduite

Comme dans Austerlitz,
une cathédrale dédiée au commerce mondial et aux échanges internationaux
sa construction inspirée par le Panthéon de Rome
la Centraal Station que décrit Jean Clair est un espace religieux,
un lieu sacré, un centre du monde où se résumaient l’alpha et l’omega de tout transport
célébrant la Célérité et le Commerce comme autrefois on avait célébré Dieu et la Vierge Marie
un sanctuaire protégé, clos de murs pesants, en contradiction flagrante avec sa fonction affichée : ouvrir au monde, dévoilant déjà sa duplicité fascinante.
De la même manière que dans le texte de Sebald, les divers éléments

et détails de l’édifice
cartouches de pierre représentant des symboles
pilastres cannelés
escalier à double révolution
grande horloge
armoiries royales
hauts miroirs de la salle d’attente
font l’objet de la part de Jean Clair d’une énumération et d’une description méticuleuses,
butoirs
construits de plaques d’acier peintes en noir et rivetées par d’épais boulons
emblèmes sculptés dans la pierre
roues ailées et caducées hermétiques
éblouissement des verrières
composant un récit d’initiation sous la forme d’un patient travelling analytique.

Comme Sebald enfin,
l’éclectisme en soi risible de Delacenserie
Jean Clair insiste sur l’étrange mélange des formes et des modèles, dévoilant le kitsch bien de son temps qui présida à sa conception. En contemplant la gare d’Anvers, écrit-il, apparaissent les éclats des plus célèbres bâtiments des siècles passés
fragments du palais de Tibère à Capri
de Saint-Marc de Venise
architraves de Palladio
rosaces de Viollet-le-Duc
contrefaçons grossières d’une production de série
réunis dans un geste à la fois vain et souverain, formidable et ridicule
une main puissante les avait saisis et, comme une roche métamorphique, sous la pression de cet événement formidable qu’avait été la révolution industrielle, les avait tordus, fondus et transformé pour en faire ce bâtiment étonnant : la Gare.
créateur d’un décor factice et instable, le même qui plonge Jacques Austerlitz dans une mélancolie à l’origine mal identifiée.
il ne pouvait s’empêcher de penser, bien que cela n’ait rien à voir avec le sujet, au tourment des adieux et à la peur de l’inconnu.

Et c’est ainsi que la Centraal Station et ses voisins: le musée des Beaux-Arts et le zoo, trois édifices dont Jean Clair souligne la proximité morale, cultuelle, physiologique, deviennent dans les deux textes autant de facettes d’un même projet mené par la bourgeoisie conquérante à l’ère du capital
À défaut d’édifier des cathédrale, des abbayes, des monastères, trop tard venue pour construire encore des palais et des folies, il lui restait à inventer de bâtir les musées et les gares pour tirer du monde profane, dont elle avait reçu gérance, des intérêts que ni les délices célestes, ni les jouissances séculières ne lui offraient plus.
et des empires
À la première classe dirigeante sans passé et de mœurs jusqu’alors sédentaires, il revenait de bâtir ces nouveaux monuments, consacrés au vertige de l’espace et au vertige du temps, de sorte à étendre sur cet espace et sur ce temps qui ne lui appartenaient pas, les marques démultipliées de sa domination.
Les reflets d’un texte dans l’autre sont en réalité si nombreux que j’ai pu penser un moment que Sebald s’était inspiré, pour sa monumentale ouverture d’Austerlitz, du Voyageur égoïste, paru près de quinze ans avant. J’ai même imaginé que Jean Clair était peut-être le modèle secret de Jacques, à moins qu’il n’apparaisse

sous d’autres traits
il ne resta plus, à part nous, qu’un buveur de Fernet solitaire
dans cette scène de rencontre inaugurale.
Le Voyageur égoïste ne figure pas dans la liste des ouvrages de la bibliothèque personnelle de Sebald (1), mais on sait que ce dernier avait pris l’habitude de se débarrasser de beaucoup des livres dont il n’avait plus l’usage pour ses travaux. Sur ce point, le mystère restera sans doute entier. Je note juste pour finir sur ce sujet que le texte de Clair sur la gare d’Anvers conclut une partie du recueil intitulée L’Europe avant la nuit.

M’intéressant, suite à cette lecture, à d’autres reflets possibles (et ils sont nombreux entre ces œuvres toutes deux placées sous le signes de Saturne), j’ai eu beaucoup moins de difficultés à repérer l’origine sebaldienne d’un passage d’un autre livre de Jean Clair
L’usage a longtemps été – aussi longtemps qu’on a cru en l’art comme on avait foi en un Dieu – , quand survenait un deuil dans une maison, de recouvrir de crêpe de soie noire tous les miroirs et tous les tableaux afin que, s’échappant du corps, l’âme du défunt ne soit déroutée ni par son propre reflet ni par les représentations peintes des visages, des paysages et des fruits de la terre qu’il fallait quitter.
(Dialogue avec les morts, Gallimard, 2011, p.62)
puisqu’il s’agit des toutes dernières lignes des Anneaux de Saturne, dans la traduction qu’en a donnée Bernard Kreiss (Actes Sud, p.347), recopiées presque mot pour mot.
Dans son dialogue avec les morts, Jean Clair, d’ordinaire si précis et si reconnaissant, oublie donc de citer sa source. Oubli d’autant plus étonnant qu’il lui rend hommage
cet écrivain éminent de la mélancolie que fut W. G. Sebald
dans un des essais compilés au sein du catalogue de la grande exposition qu’il avait dirigée au Grand Palais en 2005. J’imagine que cette histoire d’âmes errantes a emporté la plume de Jean Clair, obsédé par le désenchantement du monde contemporain, et qu’il s’agit d’un plagiat plus involontaire que mesquin (un hommage en somme).

Au sujet de cette pratique consistant à recouvrir les toiles dans les intérieurs bourgeois, j’ai par ailleurs lu, dans Le Chapeau de Vermeer de l’historien canadien Timothy Brook, une interprétation beaucoup plus prosaïque, au détour d’un commentaire de La liseuse :
Il était courant qu’on dissimule les tableaux sous un rideau pour les protéger de la lumière et d’autres dégâts éventuels.
(Payot, 2010, p.72)
Cette interprétation est-elle plus juste? Remet-elle en cause la « théorie des âmes errantes » ? Je l’ignore. Toujours est-il que dans le même ouvrage, Brook développe sa propre théorie du reflet, et elle n’est pas sans rappeler les observations de Sebald et de Clair. Selon lui la récurrence de ce motif dans les œuvres de Vermeer et d’autres peintres des Temps modernes, et plus généralement le goût de ces derniers pour les jeux de miroirs, les correspondances de toutes sortes, la mise en scène d’un monde plus vaste dans un monde plus petit, ne seraient que l’expression picturale d’une nouveauté et d’un paradoxe géographiques : l’ouverture complète et forcée du monde, entre le XVIème et le XIXème siècle, l’a dans le même temps refermé sur lui-même, si bien qu’il n’y a plus d’ailleurs qui ne se retrouve ici à un moment ou à un autre, pas de chose lointaine qui ne soit rendue proche par le truchement d’une carte, d’un objet, d’un voyage. Ainsi les reflets se multiplient et envahissent l’espace réel de la même manière qu’ils envahissent les toiles, dans un jeu d’emboitement du microcosme et du macrocosme d’où toute dimension religieuse est progressivement évacuée au profit de celle, immanente, de l’art pour l’art.

D’où il ressort finalement que les merveilleux petits tableaux de Vermeer et la monstrueuse gare d’Anvers, aussi opposés soient-ils en apparence, sont en réalité les formes symboliques d’un même processus : la sécularisation des sociétés européennes.
(1) Jo Catling, « A catalogue of W. G. Sebald’s Library » in Jo Catling et Richard Hibbitt (dir.), Saturn’s Moons, W. G. Sebald – a Handbook, Legenda, 2011.




 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier