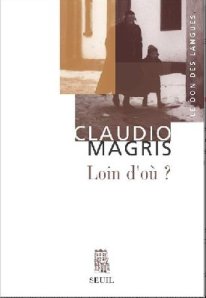Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l’Express, au sujet des nombreux suicides parmi les employés de France Télécom, dans une chronique sur LCI:
« C’est de la faute de l’Etat. L’Etat, socialement, a trop protégé ses troupes, ses fonctionnaires: pas de mutation ou d’avancement au mérite, le tranquille avancement de l’ancienneté, la sécurité de l’emploi, la culture de la fonction publique à la française (…) et il amène dans le privé des gens qui ne sont absolument pas préparés à la vie un peu plus rude, un peu plus violente. L’Etat, c’est un éleveur d’agneaux qui les lâcherait dans la forêt, sans leur avoir dit qu’il y a des loups. » (cité par Daniel Schneidermann dans Libération du 21 septembre 2009)
W. G. Sebald, Austerlitz, p.211
«Ces gens ont une façon d’écrire, il y a de quoi tourner de l’oeil. »
Il arrive qu’après un catastrophe on demande aux enfants de dessiner l’incendie, le massacre, l’accident qui les hante et qui, mis en image, pourra commencer d’être compris au sens fort du terme. Ainsi commence un travail de deuil.
Christophe Barbier n’a peut-être pas été traumatisé par les suicides à répétition à France Télécom, mais il a gardé un esprit (je ne dirais pas une âme) d’enfant.
Le monde qu’il dessine en ces mots vite écrits vite prononcés sur un des multiples « supports » où il intervient régulièrement est un espace simple, enfantin, à la géographie binaire. Une forêt, avec des loups. Un enclos, et des agneaux dedans. Du monde réel à celui de la fable ici dépossédée de la moindre charge subversive, c’est ainsi que la langue de Barbier opère un premier déplacement. On pourrait dire une première délocalisation, qui est aussi une forme de déréalisation.
Rien n’assure que tous ceux que ces morts ont touchés de près ou de loin seront apaisés par ce portrait des victimes en agneaux, mais ils sauront au moins à qui s’adresser pour demander des comptes. Car dans l’histoire le coupable n’est pas le loup mais l’éleveur d’agneau, qui n’a pas su adapter ses protégés à la sauvagerie, l’état de nature authentique qui règne dans le parc humain. Les coupables ne sont pas ceux qui précarisent le quotidien à coup de décisions managériales kafkaïennes. Ce sont au contraire ceux qui ont la faiblesse de penser qu’en lui donnant des cadres spatiaux et temporels un tant soit peu clairs et rassurants, l’être humain pourra mieux se projeter dans ce qui est en train de devenir un luxe, c’est à dire un avenir. Deuxième délocalisation: le lieu du crime n’est pas la forêt mais l’enclos.
Christophe Barbier n’a certes ni la plume ni le goût des tranchées du jeune Jünger, mais il y a dans sa « vision du monde » un air de famille, des accents qui rappellent celle de la révolution conservatrice du début du XXème siècle : un appel à la prise risque, un éloge du conflit, une promotion de l’incertitude, seuls capables de réveiller ce qu’il y a de véritablement grand en l’homme. Une condamnation du confort supposé qui gangrène une partie de la population et la rend dangereusement apathique. Dans son imaginaire infantile, Mr Barbier se voit peut-être en chef de meute et jette un regard tout à la fois désapprobateur et miséricordieux sur cette humanité inadaptée, quasiment handicapée, qui peuple encore notre pays, mais qu’une politique d’éducation bien pensée ainsi qu’un certain nombre de « réformes structurelles » pourrait enfin transformer en redoutable armée pour la guerre économique. En grand seigneur affligé de tant de gâchis, il épargne ceux qui ont flanché et réserve son courroux à l’Etat-providence qui les a si mal entraînés.

L’inquiétant dans l’histoire réside sans doute moins dans la position personnelle de Mr Barbier (insignifiante en soi) que dans la vulgate qu’elle représente. On la retrouve à peu de chose près chez ses « concurrents ». Elle avance à coup d’éditoriaux médiocres, de débats télévisés trop rapides, d’interventions d’experts improbables. Daniel Schneidermann cite dans le même article la prose vide de Jacques Attali, qualifiant d’«enjeu culturel» majeur la nécessaire transformation des Français en « nomades sédentaires ». L’inquiétant, c’est que Mr Barbier, tout comme Mr Attali, n’est pas ce qu’on pourrait appeler un extrémiste. Le journal qu’il dirige est souvent qualifié de modéré. L’inquiétant, c’est bien cette fausse modération capable d’asséner l’air docte et pénétré, sur le ton de l’analyse froide et détachée, sous le masque du bon sens, des propositions en apparence bienveillantes, en réalité de véritables défis à la décence commune et à l’intelligence. C’est la troisième délocalisation opérée par ce texte, qui déplace l’extrême au centre.
Surtout, c’est la novlangue qui sort de sa bouche de gendre idéal qui glace le sang. Cette manière de parler du monde de façon éthérée, délocalisée, cette fable à usage des puissants et à destination des autres, qui empêche toute vision claire des mécanismes qui font tourner la planète. Je lisais justement ce jour-là le petit texte qu’Eric Chauvier vient de publier, et les dernières lignes ont jeté une lumière crue sur la langue de Christophe Barbier. Il y parle de ce « langage hollywoodien » qui, à coup de gros concepts abstraits et insaisissables, nous confisque la compréhension de la réalité:

Eric Chauvier, La crise commence où commence le langage, éditions Allia, p.40
« Toutes ces phrases d’experts autoproclamés, que vous entendez dans les médias, ont pour point commun de ne spécifier aucun contexte. Je peux aussi bien remplacer le mot « crise » par le mot « dieu » ou par le mot « diable », une question demeure: avez-vous une quelconque prise sur la situation que désigne ce mot? Si je reprends la dernière phrase, soit « La crise du système est devenue une crise de confiance », pouvez-vous vous projeter distinctement dans ce « système », et comprendre les liens réels qui le relient à votre existence? Quant à cette « crise de confiance », elle n’est pas plus claire. Qu’est-ce que cet environnement glauque, sans localisation précise, où votre confiance serait en berne? (…) Ces mots ne font référence à aucun contexte. Ce sont des coquilles vides, qui planent très haut dans l’éther. »
« La langue ne ment pas », disait aussi Victor Klemperer.



 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 






 Ruelles à peine viabilisées, bâti décati ; si l’on n’y prend pas garde, on retiendrait de Majastres le charme d’un marginal et désuet recoin alpo-provençal, fidèle en cela à la personnalité et à la trajectoire centripètes de Luc Moullet.
Ruelles à peine viabilisées, bâti décati ; si l’on n’y prend pas garde, on retiendrait de Majastres le charme d’un marginal et désuet recoin alpo-provençal, fidèle en cela à la personnalité et à la trajectoire centripètes de Luc Moullet. Mais on marche ici la tête haute, notamment depuis que Les Naufragés de la D 17 a rendu cet hommage mérité à la localité. Et en adoptant cette posture, on accède à une tout autre dimension. Pourtant parfaitement protégé des nuisances, Majastres est avantageusement connecté au réseau aérien national et international. La localité jouit d’une quasi centralité au sein d’un hexagone formé par Nice-Côte d’Azur, Cannes-Mandelieu, Marseille-Provence, Avignon-Pujaut, Valence-Chabeuil et Grenoble-Isère. Le chemin vers le centrifuge est donc particulièrement court, nonobstant l’abandon de l’automobile constaté dans l’épisode 3/4 (1/2).
Mais on marche ici la tête haute, notamment depuis que Les Naufragés de la D 17 a rendu cet hommage mérité à la localité. Et en adoptant cette posture, on accède à une tout autre dimension. Pourtant parfaitement protégé des nuisances, Majastres est avantageusement connecté au réseau aérien national et international. La localité jouit d’une quasi centralité au sein d’un hexagone formé par Nice-Côte d’Azur, Cannes-Mandelieu, Marseille-Provence, Avignon-Pujaut, Valence-Chabeuil et Grenoble-Isère. Le chemin vers le centrifuge est donc particulièrement court, nonobstant l’abandon de l’automobile constaté dans l’épisode 3/4 (1/2). C’est en toute logique que les télécommunications sont particulièrement développées, la densité des flux n’a rien à envier au médiascope intercommunal des Trois Vallées de Digne-les-Bains, pourtant préfecture des Alpes de Haute-Provence.
C’est en toute logique que les télécommunications sont particulièrement développées, la densité des flux n’a rien à envier au médiascope intercommunal des Trois Vallées de Digne-les-Bains, pourtant préfecture des Alpes de Haute-Provence. Aussi la constance politique est tout à fait frappante depuis la fin du XVIIIe siècle. Les résultats électoraux les plus récents s’avèrent sans concession ni équivoque : les voix de gauche (10) font le plein : 100 % en mai 2007. Gustave Pierrisnard (divers gauche) fut réélu dans les mêmes proportions aux municipales de 2008. En y regardant de plus près, le blason de Majastres présente une dominante rouge et jaune. On se contentera de noter les nombreuses similitudes avec les bannières de l’ex-URSS et de la Chine.
Aussi la constance politique est tout à fait frappante depuis la fin du XVIIIe siècle. Les résultats électoraux les plus récents s’avèrent sans concession ni équivoque : les voix de gauche (10) font le plein : 100 % en mai 2007. Gustave Pierrisnard (divers gauche) fut réélu dans les mêmes proportions aux municipales de 2008. En y regardant de plus près, le blason de Majastres présente une dominante rouge et jaune. On se contentera de noter les nombreuses similitudes avec les bannières de l’ex-URSS et de la Chine. Comme en Union soviétique, l’électrification des Alpes de Haute-Provence fut une véritable épopée. Celle-ci est définitivement achevée en 1928, Majastres jouit aujourd’hui d’un système performant basé sur le refus du nucléaire (l’énergie nécessaire est fournie grâce aux ressources hydroélectriques voisines). On est ci-contre en présence du central électrique de l’axe principal. D’ici, les bas de Majastres, la partie la plus densément peuplée, sont alimentés. Un fonctionnement réticulaire particulièrement ingénieux permet d’atteindre l’ensemble des lieux-dits du bloc de Majastres, dont Le Poil ou encore Soleil-Bœuf.
Comme en Union soviétique, l’électrification des Alpes de Haute-Provence fut une véritable épopée. Celle-ci est définitivement achevée en 1928, Majastres jouit aujourd’hui d’un système performant basé sur le refus du nucléaire (l’énergie nécessaire est fournie grâce aux ressources hydroélectriques voisines). On est ci-contre en présence du central électrique de l’axe principal. D’ici, les bas de Majastres, la partie la plus densément peuplée, sont alimentés. Un fonctionnement réticulaire particulièrement ingénieux permet d’atteindre l’ensemble des lieux-dits du bloc de Majastres, dont Le Poil ou encore Soleil-Bœuf. La réplique ne s’est pas fait attendre ; un nouveau module téléphonique a été installé en 1992. Aucune fente, ni pour pièce, ni pour carte, les communications sont gratuites.
La réplique ne s’est pas fait attendre ; un nouveau module téléphonique a été installé en 1992. Aucune fente, ni pour pièce, ni pour carte, les communications sont gratuites. Quant à la boîte à lettre, elle est avantageusement placée et les malejactois jouissent d’une distribution et d’une levée quotidienne du courrier, du lundi au vendredi. Le facteur est sympa, aime son métier, mais pas au point de sacrifier son samedi.
Quant à la boîte à lettre, elle est avantageusement placée et les malejactois jouissent d’une distribution et d’une levée quotidienne du courrier, du lundi au vendredi. Le facteur est sympa, aime son métier, mais pas au point de sacrifier son samedi.



 L’absence de mention des curiosités locales (comme : « Majastres : son église, son lavoir, ses parkings gardés, ses 3 épis au label des cités fleuries… ») entretient un mystère tout à fait excitant. Le visiteur est invité à une entreprise d’appropriation du lieu, à y trouver son propre cheminement. Et celui-ci peut très bien être intérieur, pour ne pas dire spirituel. Ainsi l’expression « vous êtes projet » place-t-elle d’abord dans l’expectative, sentiment vite remplacé par de stimulantes interrogations sur le sens à y donner.
L’absence de mention des curiosités locales (comme : « Majastres : son église, son lavoir, ses parkings gardés, ses 3 épis au label des cités fleuries… ») entretient un mystère tout à fait excitant. Le visiteur est invité à une entreprise d’appropriation du lieu, à y trouver son propre cheminement. Et celui-ci peut très bien être intérieur, pour ne pas dire spirituel. Ainsi l’expression « vous êtes projet » place-t-elle d’abord dans l’expectative, sentiment vite remplacé par de stimulantes interrogations sur le sens à y donner. La vastitude du bloc de Majastres est particulièrement perceptible à la sortie de la localité : pas de panneau de signalisation pour en signifier le terme, le bitume s’arrête brusquement pour laisser place à une chaussée caillouteuse semblant ouvrir vers un monde à la fois finissant et infini. Une voie non carrossable qu’il est pourtant nécessaire d’emprunter pour qui veut rejoindre la gare de Majastres-Le Poil. Dans le préambule des Naufragés de la D 17, Luc Moullet ne manque pas de faire remarquer qu’il s’agit de « la seule gare de France avec une faute d’orthographe » puisqu’avant le trait d’union, le « s » final manque.
La vastitude du bloc de Majastres est particulièrement perceptible à la sortie de la localité : pas de panneau de signalisation pour en signifier le terme, le bitume s’arrête brusquement pour laisser place à une chaussée caillouteuse semblant ouvrir vers un monde à la fois finissant et infini. Une voie non carrossable qu’il est pourtant nécessaire d’emprunter pour qui veut rejoindre la gare de Majastres-Le Poil. Dans le préambule des Naufragés de la D 17, Luc Moullet ne manque pas de faire remarquer qu’il s’agit de « la seule gare de France avec une faute d’orthographe » puisqu’avant le trait d’union, le « s » final manque. Dans Majastres, on est hésitant, quelque peu bousculé. Serait-on en présence du cimetière de la modernité, une sorte de vanité grinçante de la civilisation des trente glorieuses ?
Dans Majastres, on est hésitant, quelque peu bousculé. Serait-on en présence du cimetière de la modernité, une sorte de vanité grinçante de la civilisation des trente glorieuses ? Marcheur, cycliste, féroce pourfendeur de l’automobile ; la pensée de Luc Moullet a-elle infusé à ce point les habitants du village, qui, à la vision de la fin apocalyptique des Naufragés de la D 17, auraient abandonné l’usage de la voiture, en les délaissant avec négligence sur le bord de la voirie ? Tout laisse à penser que c’est le cas, même s’il fut impossible de recueillir le moindre témoignage à ce sujet.
Marcheur, cycliste, féroce pourfendeur de l’automobile ; la pensée de Luc Moullet a-elle infusé à ce point les habitants du village, qui, à la vision de la fin apocalyptique des Naufragés de la D 17, auraient abandonné l’usage de la voiture, en les délaissant avec négligence sur le bord de la voirie ? Tout laisse à penser que c’est le cas, même s’il fut impossible de recueillir le moindre témoignage à ce sujet.




 L’homme était compliqué (c’était un mythomane achevé) et son œuvre est de toute manière ambigüe. Magris a rappelé lors de cette rencontre qu’il n’était pas, comme Musil, de ceux qui écrivaient « tout autant avec leur main qu’avec leur tête ». Roth écrivait d’abord avec sa main, au risque de l’incohérence idéologique. Le jeu de duettiste de jeudi a d’ailleurs parfaitement rendu compte de ces tiraillements. Les questions de Dauzat ont souvent tenté de tirer Roth du côté nihiliste et désenchanté de son oeuvre, mais Magris a toujours réussi à sauver ce qui relevait de l’utopie.
L’homme était compliqué (c’était un mythomane achevé) et son œuvre est de toute manière ambigüe. Magris a rappelé lors de cette rencontre qu’il n’était pas, comme Musil, de ceux qui écrivaient « tout autant avec leur main qu’avec leur tête ». Roth écrivait d’abord avec sa main, au risque de l’incohérence idéologique. Le jeu de duettiste de jeudi a d’ailleurs parfaitement rendu compte de ces tiraillements. Les questions de Dauzat ont souvent tenté de tirer Roth du côté nihiliste et désenchanté de son oeuvre, mais Magris a toujours réussi à sauver ce qui relevait de l’utopie. Parcourir la D 17, c’est aussi la découverte de ces étranges formations géologiques que sont les roubines, à propos desquelles Luc Moullet confie : « Je suis en effet assez sensible à la beauté, à cette beauté en tous cas, celle des roubines, assez profondes, assez austères. Cette beauté dure, âpre, n’est évidemment pas la beauté de tout le monde. » Signalons que la roubine représentée n’est pas des plus spectaculaires, il s’agirait d’ailleurs ici plutôt d’une pré-roubine, puisque les roubines se signalent par une totale nudité en matière de végétation. On sera davantage subjugué par celles que l’on voit dans Une Aventures de Billy le Kid
Parcourir la D 17, c’est aussi la découverte de ces étranges formations géologiques que sont les roubines, à propos desquelles Luc Moullet confie : « Je suis en effet assez sensible à la beauté, à cette beauté en tous cas, celle des roubines, assez profondes, assez austères. Cette beauté dure, âpre, n’est évidemment pas la beauté de tout le monde. » Signalons que la roubine représentée n’est pas des plus spectaculaires, il s’agirait d’ailleurs ici plutôt d’une pré-roubine, puisque les roubines se signalent par une totale nudité en matière de végétation. On sera davantage subjugué par celles que l’on voit dans Une Aventures de Billy le Kid En progressant sur la D 17, la qualité du revêtement se dégrade considérablement et le parcours devient souvent impressionnant, de profondes gorges recueillent bien souvent les véhicules trop pressés, ici entre les lieux-dits de Palus et de Gros-Jas.
En progressant sur la D 17, la qualité du revêtement se dégrade considérablement et le parcours devient souvent impressionnant, de profondes gorges recueillent bien souvent les véhicules trop pressés, ici entre les lieux-dits de Palus et de Gros-Jas. Autre dégradation, celle de la rationalité et de la cohérence inaugurales. Il paraît hautement improbable qu’il puisse se trouver un kilomètre 27 de la D 17 qui n’en compte que 17. Et c’est avec un peu d’effroi, les mains moites sur le volant, que l’on traverse ensuite la minuscule localité de Saule-Mort.
Autre dégradation, celle de la rationalité et de la cohérence inaugurales. Il paraît hautement improbable qu’il puisse se trouver un kilomètre 27 de la D 17 qui n’en compte que 17. Et c’est avec un peu d’effroi, les mains moites sur le volant, que l’on traverse ensuite la minuscule localité de Saule-Mort. Toujours dans le même ordre d’idée que précédemment, le kilomètre 24 de la D 17 qui n’en compte que 17 a bizarrement tendance à se répéter à plusieurs reprises. Et on ne peut considérer que ce panneau de signalisation très fourni inspire une grande confiance. Sur ce dernier, la découverte de la mention « voie en lacune » fut aussi intrigante que désarmante. Mais Majastres approche, d’une manière un peu bestiale, on guette les traces de sa présence.
Toujours dans le même ordre d’idée que précédemment, le kilomètre 24 de la D 17 qui n’en compte que 17 a bizarrement tendance à se répéter à plusieurs reprises. Et on ne peut considérer que ce panneau de signalisation très fourni inspire une grande confiance. Sur ce dernier, la découverte de la mention « voie en lacune » fut aussi intrigante que désarmante. Mais Majastres approche, d’une manière un peu bestiale, on guette les traces de sa présence. On entre alors dans les terres de Luc Moullet, qui, tout en étant un homme de cinéma français ayant fait de cette rude contrée son terroir, se définit comme un cinéaste anglais d’origine arabe dont la véritable profession serait le trekking. Ce n’est pas la moindre de ses fantaisies, mais pas la seule.
On entre alors dans les terres de Luc Moullet, qui, tout en étant un homme de cinéma français ayant fait de cette rude contrée son terroir, se définit comme un cinéaste anglais d’origine arabe dont la véritable profession serait le trekking. Ce n’est pas la moindre de ses fantaisies, mais pas la seule.
 Cette route départementale est parfaitement cohérente et rationnelle, son chiffre correspond exactement au nombre de kilomètres nécessaires pour atteindre son but.
Cette route départementale est parfaitement cohérente et rationnelle, son chiffre correspond exactement au nombre de kilomètres nécessaires pour atteindre son but. Alors que l’on distingue nettement dans le film de Luc Moullet une chaussée laissant à désirer, l’asphalte est ici d’excellente qualité, un véritable tapis de billard quasiment immaculé. Ceci est certainement lié aux nombreuses retombées économiques des Naufragés de la D 17
Alors que l’on distingue nettement dans le film de Luc Moullet une chaussée laissant à désirer, l’asphalte est ici d’excellente qualité, un véritable tapis de billard quasiment immaculé. Ceci est certainement lié aux nombreuses retombées économiques des Naufragés de la D 17 Des indications précises et une voierie en bon état ; voilà qui est heureux car le parcours est très sinueux et accidenté, certains passages se révèlent particulièrement éprouvants pour le conducteur qui doit revêtir les habits de pilote chevronné, à l’image du personnage campé par Patrick Bouchitey dans ledit film.
Des indications précises et une voierie en bon état ; voilà qui est heureux car le parcours est très sinueux et accidenté, certains passages se révèlent particulièrement éprouvants pour le conducteur qui doit revêtir les habits de pilote chevronné, à l’image du personnage campé par Patrick Bouchitey dans ledit film.

 La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…
La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…