
Austerlitz, p.137
« Une fois que nous fûmes arrivés à Liverpool Street Station, où il attendit avec moi le départ de mon train dans le restaurant McDonald’s, il reprit enfin le fil de son histoire, après une remarque incidente sur l’éclairage de l’endroit, trop cru pour laisser planer le soupçon d’une ombre: la seconde d’effroi à l’instant du flash, dit-il, était ici pérennisée et il n’y avait plus d’espace ni pour le jour ni pour la nuit. »
Les Anneaux de Saturne, p.102
« J’ai passé une bonne heure à flâner dans ce quartier plus ou moins extraterritorial. Dans les ruelles latérales, des planches étaient clouées sur la plupart des fenêtres et les murs de briques couverts de suie s’ornaient de slogans tels que Help de regenwouden redden et Welcome to the Royal Dutch Graveyard. Je n’étais plus d’humeur à entrer dans un café pour me restaurer. Au MacDonald où, planté sous la lumière crue du comptoir, je me suis senti comme un malfaiteur recherché depuis des lustres par toutes les polices du monde, je m’offris un paquet de chips que je grignotais en m’en retournant à l’hôtel. » (traductions Patrick Charbonneau)
La lumière des néons suspend le temps et l’espace. Identique en tout lieu, non-lieu par excellence, le Macdonald’s porte à son apogée le sentiment d’être nulle part et partout, jours et nuits confondus, phénomène qui avait déjà tant surpris les hommes de la fin du 19ème siècle, au moment où l’éclairage électrique s’est imposé à grande échelle (1).
Chronologiquement, c’est d’abord dans les Anneaux de Saturne, en août 1991 – un an « très exactement » (p.100) avant d’entamer son tour dans le Suffolk – que le narrateur pénètre par hasard dans un de ces restaurants. Il se trouve alors en Hollande, au soir de son arrivée à La Haye, mais l’épisode est remémoré depuis la Gunhill de Southwold, du côté anglais de l’« Océan allemand ». Ses premiers pas hors de l’hôtel sont pour le moins erratiques mais, aussi étranges et labyrinthiques qu’elles paraissent au premier abord, les rues et ruelles qu’il emprunte restent localisables et identifiables. Un « minaret (…) dans l’azur hollandais vespéral » (p.102) lui (nous) dit qu’il traverse un morceau d’orient en occident, un de ces quartiers relégués de grande métropole européenne, né, ici comme ailleurs, des mouvements migratoires mis en branle par la modernité industrielle. Le narrateur sebaldien, éminemment moderne lui aussi, n’y est en fait jamais totalement perdu (2). Il sait où il est.
Le McDonald’s offre une forme d’« extraterritorialité » plus extrême. Le personnage y est en effet confronté à ce que Marc Augé appelle la « surmodernité » dans ce qu’elle a de plus standardisée et impersonnelle. La délocalisation engendrée par les non-lieux – autoroutes, aéroports, supermarchés, chaînes mondialisées de restauration rapide, etc. – est d’une toute autre nature que celle que provoquent des rues étrangères. Les hommes sont réduits à l’état de clients, accueillis pour un temps limité et contractualisé, en un lieu qui ne leur offre qu’une « identité provisoire », ce qui les condamne, paradoxalement, à l’anonymat (3).

Le McDonald’s décuple donc la sensation d’égarement et fait naître un sentiment de culpabilité vague, d’angoisse à l’idée de perdre une identité toujours à prouver: impression typiquement sebaldienne d’inquiétante étrangeté que l’on retrouve, en particulier, dans la deuxième partie de Vertiges, All’Estero.
Cet épisode liminaire est de mauvais augure. Le Voyage en Hollande, sur les pas de Diderot et sur les traces de la Leçon d’anatomie du Dr Nicolaas Tupp peinte par Rembrandt, est bien, dès le premier jour, une déception, comme le souligne Martine Carré dans un bel essai paru en 2008 (4). Non que le texte de l’écrivain-philosophe l’ait trahi, mais parce que le narrateur-enquêteur a failli, s’est égaré.

Le même inconfort accompagne la narration par Austerlitz des derniers moments de la vie de son ami Gerald Fitzpatrick, qui clôt la partie galloise de l’autobiographie, entamée la veille au Great Eastern Hotel. En cette fin de journée pluvieuse du 24 décembre 1996, les deux personnages reviennent de leur promenade à l’observatoire de Greenwich, et attendent, réfugiés dans le fast-food, le train du narrateur.
Comme deux papillons tout ensemble attirés et effrayés par les lumières crues, ils se figent un moment que la prose dilate (5). Suspension, entre-deux, qui laissent la place au récit. Cette deuxième visite au McDonald’s est plus productive que la première, mais c’est tout le quartier de la Liverpool Street Station qui rayonne d’une aura dont la suite du texte précise peu à peu l’origine .
Notes:
(1) Stephen Kern, The Culture of Time and Space (1880-1918), p.29: « One of the many consequences of this versatile, cheap and reliable form of illumination was a blurring of the division of day and night ».
(2) John Zilkosky a montré dans un des premiers recueils d’articles consacrés à Sebald que la désorientation n’était jamais complète dans son oeuvre, qu’elle était toujours provisoire, et que les hasards mettaient souvent le narrateur sur des routes déjà fréquentées, par lui ou d’autres. Les tentatives pour se perdre, comparées aux aspirations romantiques ou, dans un registre différent, post-modernes, sont toujours vouées à l’échec. Les non-lieux comme le McDonald’s mettent un instant ce modèle à l’épreuve, mais n’infirment pas les conclusions de Zilkosky. Sebald reste un moderne dans un monde « surmoderne ». cf John Zilkosky, « Sebald’s Uncanny travels », in J. J. Long et Anne Whitehead, WG Sebald, A Critical Companion, UWP, 2004
(3) Non-lieux, paru au Seuil en 1992, notamment p.126-127 .
(4) Martine Carré, WG Sebald, le retour de l’auteur, PUL, 2008, p.112-113
(5) Muriel Pic insiste beaucoup sur ce motif du papillon, sur cette alternance de mobilité et de fixité, et sur la fusion du chasseur et de la proie dans son essai L’image papillon, paru aux presses du réel (juin 2009).
Photo: Martin Parr, série « Common sense ». L’oeil en la matière.

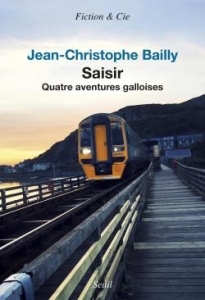





 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 
















