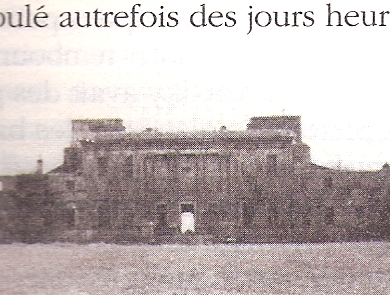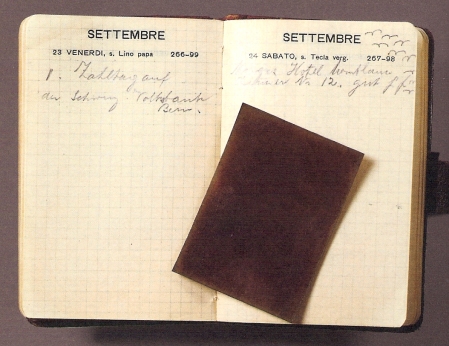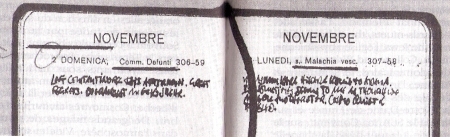Aharon Appelfeld, Le temps des prodiges, p.22
– Que faites-vous donc ? demanda Brum.
– Rien, je me promène.
– Cela ne vous ennuie pas ?
– Non, certains endroits me rappellent des souvenirs.
p.154
On claqua le portail sur nous, nous étions prisonniers du temple où nous n’avions jamais mis les pieds.
En 1965 Bruno A. revient dans la petite ville autrichienne où, à la fin des années trente, une ombre, comme une nuée de corbeaux, a commencé de gagner son territoire – la demeure familiale au bout de l’avenue des Habsbourg, la maison de vacances près de Baden, le train express qui chaque été ramenait les A. de l’une à l’autre – puis les visages familiers – la tante Theresa, son père « l’écrivain A. »
Il s’enfermait dans sa chambre, travaillait jour et nuit et partait ainsi en guerre contre les mauvais esprits qui ne cessaient de frapper à notre porte depuis l’été
– avant de les engloutir, sa mère et lui, et avec eux tous les juifs autrichiens de la petite ville autrichienne. Un soir on les amena derrière les grilles de la synagogue, on les referma sur eux, et le lendemain on les déporta.
Les longs voyages en train, dans les vapeurs d’alcool et les bouffées de haine, les arrêts involontaires dans les petites gares hors du temps,

les intérieurs empesés et fragiles de la bourgeoisie éclairée (aveugle) d’Europe centrale,

« la pluie fine » qui « découpait l’avenue en tranche humides ».
Ces images me rappellent d’autres retours au pays natal.

Le début du Regard d’Ulysse : l’arrivée en Grèce d’un autre A., le cinéastes exilé, sur la place d’une autre petite ville. Le cinéma a été fermé sous la pression des « intégristes » et son film est projeté sur le marché. Accompagné de deux hommes il marche sous la pluie, pendant que la foule de ses admirateurs fait face à la foule de ses ennemis. Dans le Temps des prodiges, au premier soir de son retour, Bruno erre comme lui dans les rues de son passé. Le cinéma est déserté pour d’autres raisons et la séance n’a pas lieu.
Je pense aussi à un voyage en train d’Allemagne en Ukraine, le retour aux sources de Svetlana Geier, la traductrice allemande de Dostoïevski. Un documentaire vient de sortir, qui suit son travail méticuleux sur les textes, ses pas mal assurés sur la neige et le verglas, au pied de son immeuble d’enfance à Kiev, sa recherche de la datcha familiale à jamais perdue dans les forêts.
Elle a toujours en tête le bruit des rafales tirées à Babi Yar.

Elle dit « cela n’est jamais devenu du passé ».

Je me contenterai de ces rapprochements. De la prose magique d’Appelfeld, j’aurais bien du mal en effet à révéler les tours subtils et puissants qui font entrer dans un mauvais rêve avec les moyens les moins spectaculaires qui soient, les phrases les plus innocentes.
Je me souviens de la claire lumière du soir qui reposait, comme du métal en fusion, sur les doubles fenêtres. Le poêle était rempli de braises; mais je me rappelle encore mieux ce paquet d’ombres qu’apporta une jeune femme et qu’elle posa à terre avec le soin que l’on a pour de longs objets délicats; elle portait aussi un panier d’osier avec un bébé dedans.
Soudain, la pluie tomba à verse. Un des ennemis de mon père se mit à publier des articles dénigrant son œuvre.
Déjà, pendant les dernières grandes vacances, dans la maison de campagne de tante Gusta, une évidence s’imposait : la lumière et les arbres n’étaient plus les nôtres.
J’y vois des reflets de celle de Walser, dont J. M. Coetzee avait dans un article relevé les traits les plus saillants : « its lucid syntatic layout, its casual juxtapositions of the elevated with the banal, and its eerly convincing logic of paradox ».
Ainsi ce passage du Temps des prodiges, à l’enterrement de la tante Theresa
La paix régnait sur ses yeux clos. Ma mère s’approcha du cercueil, la tête un peu penchée, comme on regarde un bébé dans un berceau.
On (et Appelfeld lui-même) a aussi associé sa manière d’écrire à celle de Kafka. C’est vrai bien sûr, mais un Kafka « d’après », ou, plus précisément, « des années après », comme l’annonce le titre de la deuxième partie, « quand tout fut accompli».
Photogrammes tirés du Regard d’Ulysse, de Théo Angelopoulos (1995) et de La femme au cinq éléphants de Vadim Jendreyko (2010)

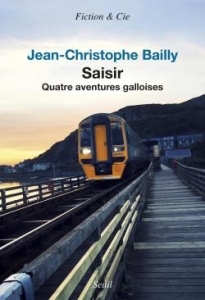





 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier