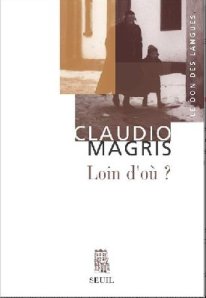Thomas Bernhard, Maîtres anciens, p.32-33
Ce n’est pas pour rien que, depuis plus de trente ans, je vais au Musée d’art ancien. D’autres vont au café le matin et boivent deux ou trois verres de bière, moi je viens m’asseoir ici et je contemple le Tintoret. Une folie peut-être, pensez-vous, mais je ne puis faire autrement. (…) Ici, dans la salle Bordone, j’ai les meilleures possibilités de méditation et si j’ai par hasard ici, sur cette banquette, quelque chose à lire, par exemple mon cher Montaigne, ou mon Pascal qui m’est peut-être plus cher encore, ou mon Voltaire qui m’est encore beaucoup plus cher, comme vous voyez les écrivains qui me sont chers sont tous français, pas un seul allemand, je peux le faire ici de la manière la plus agréable.
Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, p.41-42
Ne serait-il pas dès lors présomptueux de vous énumérer ici, en me prévalant d’une apparente objectivité ou sobriété, les pièces et sections principales d’une bibliothèque, ou de vous exposer sa genèse, voire son utilité pour l’écrivain ? En ce qui me concerne, en tout cas, je vise dans ce qui suit quelque chose de moins voilé, de plus tangible ; ce qui me tient à cœur, c’est de vous permettre un regard sur la relation d’un collectionneur à ses richesses, un regard sur l’acte de collectionner plutôt que sur une collection.
(Rivage poche « Petite bibliothèque », traduction de Philippe Ivernel)
Hédi Kaddour, Les Pierres qui montent, p.324
Relecture annuelle du Discours de la méthode. On y sent toujours un vent d’avenir.
De manière moins compulsive, plus distanciée et raisonnable que Reger, plus proche en cela d’Hédi Kaddour (Descartes contre Pascal), je reviens aux mêmes textes, souvent au printemps. A la fiction spatiale de l’île déserte je préfère la métaphore temporelle des saisons qui isole plus précieusement les livres qui comptent dans l’unité d’un temps que dans celle d’un lieu (mais des lectures et des lieux, j’ai déjà parlé ici).
C’est aussi plus réaliste. L’île déserte est une utopie, pas seulement parce qu’aujourd’hui le globe est toujours mieux connu, plus relié et moins désert, mais parce que le dégoût naitrait immanquablement de la relecture en circuit fermé des mêmes ouvrages, sans la respiration que procure la découverte des autres. Ceux qui tiennent à cœur gagnent à être quelque peu noyés dans un flux de lectures plus ou moins heureuses d’où ils émergent plus facilement.
Je déballe ma bibliothèque, comme dirait l’autre, mais la toute petite, celle des éternels retours, huit livres au total:
Reger revoyant encore et encore le Portrait de l’homme à la barbe blanche dans la salle Bordone du Musée d’Art Ancien de Vienne, vu par Irrsigler, vus par Atzbacher dans Maîtres anciens.
 Sebald : surtout les Anneaux de Saturne, et un petit texte qui me revient de plus en plus entre les mains, sa promenade au cimetière de Piana qui donne son titre au recueil posthume Campo Santo
Sebald : surtout les Anneaux de Saturne, et un petit texte qui me revient de plus en plus entre les mains, sa promenade au cimetière de Piana qui donne son titre au recueil posthume Campo Santo , une anabase. Après avoir plongé dans l’eau de la Méditerranée le narrateur remonte interroger les tombes à flanc de versant et en vient à méditer sur le combat inégal, horizontal celui-là, que se livrent les morts et les vivants depuis que l’urbanisation a gagné des portions toujours plus larges des terres habitées.
, une anabase. Après avoir plongé dans l’eau de la Méditerranée le narrateur remonte interroger les tombes à flanc de versant et en vient à méditer sur le combat inégal, horizontal celui-là, que se livrent les morts et les vivants depuis que l’urbanisation a gagné des portions toujours plus larges des terres habitées.
Campo Santo, p.39
Où les mettre, les morts de Buenos Aires et de Sao Paulo, de Mexico City, de Lagos et du Caire, de Tokyo, de Shanghai et de Bombay?
La vraie Vie de Sebastian Knight de Nabokov, le premier de ses textes écrits en anglais. Il est peut-être moins virtuose que les autres, mais le ton amusé, faussement léger de l’enquête m’a toujours séduit.  Je relis aussi souvent Autre Rivages, où je trouve une atmosphère comparable. Les deux forment un diptyque à mes yeux.
Je relis aussi souvent Autre Rivages, où je trouve une atmosphère comparable. Les deux forment un diptyque à mes yeux.
Celui qui m’est sans doute le plus cher : le Jardin des plantes de Claude Simon (je le relis en ce moment), son temps retrouvé. Il y a des rapprochements étonnants à faire avec les Anneaux de Saturne, écrit avant, et j’en ferai bientôt. Au revers de la couverture de son exemplaire Sebald a ébauché la première chronologie d’Austerlitz.
Chaque année une année des Carnets de notes de Bergounioux.
La nouvelle de William Gass, Au cœur du cœur de ce pays, last but not least.
Il y en a qui sont revenus moins souvent – tous les deux, trois, quatre ans :
La Montagne magique
Danube, et Microcosmes de Claudio Magris
Le Joueur, de Dostoïevski, que je relis juste avant ou juste après un Eté à Baden Baden, de Leonid Tsipkyn, un superbe récit sur les pas du grand Fiodor, l’œuvre unique d’un petit fonctionnaire soviétique mort au début des années 80.
Le premier tome (ou partie) de l’Homme sans qualité (voir ici pour quelques réflexions sur ce travers que je partage avec beaucoup de lecteurs). Deux petits livres complémentaires, d’un grand musilien : Prodiges et vertiges de l’analogie et Le philosophe chez les autophages, de Jacques Bouveresse. Même discipline intellectuelle, même ironie, même vertu, le geste d’essuyer régulièrement ses verres de lunette.
La Recherche, je ne la relis pas, pour la bonne raison que je ne l’ai pas encore lue en entier, et ceci pour une autre bonne raison : je relis plus que de raisonnable la deuxième partie d’A l’ombre des jeunes filles en fleur.
Certains livres, longtemps revisités, ont peu à peu disparu: les grands romans de Faulkner. D’autres reviennent : grand plaisir, si je puis dire, à la Nausée, après quelques années au loin. L’épreuve peut être cruelle: le Testament à l’anglaise de Coe, le Dalhia noir d’Ellroy n’ont pas tenu les dix ou quinze ans passés depuis le premier enthousiasme.
Des raisons très diverses et très communes expliquent sans doute ma propension à la relecture, mais je préfère ici rechercher des motifs plus littéraires. D’abord ce qui pourrait être perçu comme des insuffisances. Contrairement à Nabokov, j’ai en effet beaucoup de mal à me représenter précisément la scène décrite, à m’imaginer Gregor en gros scarabée plutôt qu’en cafard (il serait plutôt un mélange des deux, avec, selon les gros plans du texte, telle ou telle partie du corps d’un insecte, telle autre d’un autre insecte), à me dessiner clairement l’appartement de la famille Samsa.
Je lis un peu flou, et je ne m’inquiète pas vraiment de rendre ma lecture plus claire ou plus fidèle à la lettre. Une proie idéale pour Flaubert qui, malgré les méticuleuses recherches qu’il s’imposait, souhaitait justement créer une image brouillée, propice à l’imagination.
Le manque de disposition à identifier les détails exacts, les défauts de concentration dans le suivi des intrigues, les erreurs souvent énormes quant aux relations entre les personnages (leur nom même m’échappe souvent, et je suis impressionné quand je lis ensuite le résumé limpide que font les critiques de certains gros et complexes récits), tout cela permet aussi de ne garder que des impressions, des souvenirs de « grands moments », quitte à mal les placer dans l’économie générale de l’œuvre.  Après bien des relectures des textes Sebald il m’est difficile de dire si telle traversée de banlieue se trouve dans les Anneaux ou dans les Emigrants, telle remarque sur les feux de forêt dans un court texte de Campo Santo ou dans Austerlitz (en fait les deux, mais aussi dans les Anneaux), etc.
Après bien des relectures des textes Sebald il m’est difficile de dire si telle traversée de banlieue se trouve dans les Anneaux ou dans les Emigrants, telle remarque sur les feux de forêt dans un court texte de Campo Santo ou dans Austerlitz (en fait les deux, mais aussi dans les Anneaux), etc.
Il y a enfin une parenté entre ces œuvres, qui correspondent à ce type de lecture impressionniste, puisque la plupart de celles que j’ai citées, quand il ne s’agit pas de journaux, manquent justement de cette ligne droite, de cette colonne vertébrale bien articulée (les lopins à la Montaigne du jardin mémoriel de Claude Simon).
Ou plutôt elles n’en manquent pas mais leurs auteurs (les auteurs que j’aime) l’ont recouverte d’une telle épaisseur de digressions, de rêveries, de fausses pistes, que je la perds assez vite de vue tout en me laissant inconsciemment porté par elle.














 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 





















 La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…
La rentrée littéraire est donc un moment à part de mon année de lecteur. Je délaisse quelques semaines l’océan de la grande bibliothèque universelle, qu’une vie entière ne suffit pourtant pas à explorer, pour barboter dans la petite piscine de la production la plus contemporaine avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Métaphores mal choisies en l’occurrence: la mer est en matière littéraire plus confortable, mieux balisée et plus sûre que la pataugeoire. Et puis certaines espèces d’écrivains nagent aussi bien dans l’une que dans l’autre. Passons…