
Herman Melville, Moby Dick
Mais voyez ! D’autres encore s’approchent en foule et se dirigent tout droit vers l’eau ; on croirait qu’ils vont y plonger. Étrange ! Rien d’autre ne les satisfera que la plus extrême limite de la terre ; flâner à l’ombre abritée de ces entrepôts ne leur suffirait pas. Non. Il leur faut aller aussi près du bord qu’il est possible sans risque de tomber à l’eau. Et ils se tiennent là, alignés sur des milles, des lieues et des lieues… Tous viennent de l’intérieur des terres par des ruelles et des allées, des rues et des boulevards – au nord, à l’est, au sud, à l’ouest ; mais c’est ici qu’ils se retrouvent. Dites-moi : est-ce la force magnétique des aiguilles du compas de tous ces navires qui les attire en ce point ?
(Gallimard, traduit par Philippe Jaworsky, Pléiade, p.22)
W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne
Lors de l’enterrement au petit cimetière de Framingham Earl, je ne pus m’empêcher de songer à l’enfant de troupe Francis Browne qui avait sonné du clairon dans la nuit, en été 1914, dans la cour d’une école du Northamptonshire, et à la jetée blanche de Lowestoft qui avançait si loin dans la mer. Frederick Farrar m’avait appris que la population ordinaire, qui n’avait évidemment pas accès au bal de bienfaisance, se rendait à bord de centaines de barques et de canots jusqu’au bout de la jetée ; de ces observatoires qui ne cessaient d’osciller doucement et, parfois, de dériver, les gens regardaient la bonne société danser en rond au son de l’orchestre, comme soulevée par une vague de lumière au-dessus de l’eau noire, le plus souvent déjà nappée de brouillard au seuil de l’automne.
(Actes Sud, traduit par Patrick Charbonneau, p.64-65)

Longtemps je me suis buté à la première phrase de Moby Dick
Call me Ishmaël.
qui m’apparaissait comme le « je me suis couché de bonne heure » américain, c’est-à-dire l’image inversée, mais le reflet quand même, de ce que la littérature européenne a pu produire de plus fascinant
(dont le français
Je m’appelle Ishmaël. Mettons. (Giono, 1941)
Appelons-moi Ismahel. (Guerne, 1954)
Appelez-moi Ismaël. (Jaworsky, 2006)
ne traduit qu’imparfaitement la puissance démiurgique, l’effet enchanteur, le désenchantement amer. Mais qui suffisait pourtant à me figer (Roberto Bolano dit que « la traduction est une enclume » à l’épreuve de laquelle la grande littérature résiste toujours.))
Trois mots si impérieux qu’ils semblent commander au lecteur de quitter séance tenante le cours de son existence pour plonger corps et âme dans le texte ; si simples et définitifs qu’ils semblent receler la vérité de toute littérature, décourageant l’idée même d’en poursuivre d’une quelconque manière l’exercice.

M’étant enfin décidé à ne plus rester au bord, j’ai cependant été arrêté, aussitôt cette première barrière passée, par un autre reflet, d’un autre début, où l’homme, seul cette fois, recherche aussi le commerce de l’eau, comme on recherche celui des morts, de dieu, du diable; où un obscur désir de rivage nait pareillement d’un moment de grand doute.
En effet ce que je lisais chez Melville
Il y a quelques années de cela – peu importe combien exactement -, comme j’avais la bourse vide, ou presque, et que rien d’intéressant ne me retenait à terre, l’idée me vint de naviguer un peu et de revoir le monde marin. C’est ma façon à moi de chasser la morosité et de corriger les désordres de mes humeurs. Quand je sens l’amertume plisser mes lèvres, quand bruine dans mon âme un humide novembre et que je me surprends à faire halte, malgré moi, devant un marchand de cercueils, à me glisser dans le premier cortège funèbre que je croise, et, surtout, quand la noire mélancolie me tient si fort que seul un robuste sens moral peut m’empêcher de descendre d’un pas décidé dans la rue et d’envoyer méthodiquement valser les chapeaux des passants – alors, j’estime nécessaire de m’embarquer sans délai.
me rappelait Sebald, au commencement des Anneaux de Saturne, à ceci près que celui qui parle reste à terre, au bord de ce qu’il nomme « l’Océan allemand »
En août 1992, comme les journées du Chien approchaient de leur terme, je me mis en route pour un voyage à pied dans le reste de l’Angleterre, à travers le comté de Suffolk, espérant parvenir ainsi à me soustraire au vide qui grandissait en moi à l’issue d’un travail assez absorbant. Cet espoir devait d’ailleurs se concrétiser jusqu’à un certain point, le fait étant que je me suis rarement senti aussi libre que durant ces heures et ces jours passés à arpenter les terres partiellement inhabitées qui s’étendent là, en retrait du bord de mer.
J’ai par la suite trouvé dans Moby Dick bien d’autres reflets annonciateurs de la prose des Anneaux, à commencer par ces passages que j’ai mis en exergue, évoquant des lieux inaccessibles vers lesquels convergent malgré tout les foules, attirées aux bouts du monde comme des insectes par une lumière blanche ;

ou encore les dizaines d’Extracts (supplied by a sub-sub-librarian) placés par Melville au début de son roman, dont un est tiré des Vulgar Errors de Sir Thomas Browne
Ce qu’est la baleine, les hommes ont le droit de se le demander, puisque le savant Hosmanus, dans son ouvrage de cinquante ans dit clairement : « Nescio quid sit ».
et un autre
Plusieurs baleine sont venues s’échouer sur cette côte (Fife), Anno 1652, l’une d’elles, de l’espèce à fanons, qui mesurait quatre-vingt pieds de long, donna (à ce qu’on m’a dit) une énorme quantité d’huile, mais aussi cinq cents livres de baleines à corsets. Ses mâchoires servent de portail dans le jardin de Pittfiren.
attribué à un certain Sibbald, géographe et naturaliste écossais du même dix-septième siècle que Browne, auteur d’une Histoire naturelle de son pays, dont le nom, nous dit Philippe Jaworsky, réapparait à deux reprises dans la suite du texte.
Il y a aussi cette question que Sebald aurait pu faire sienne, posée par Ismaël dans la chapelle de New Bedford
D’où, que les vivants s’acharnent à réduire les morts au silence ?


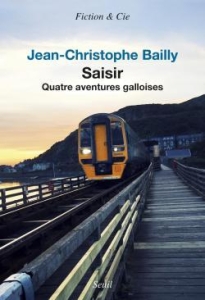





 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier 
















