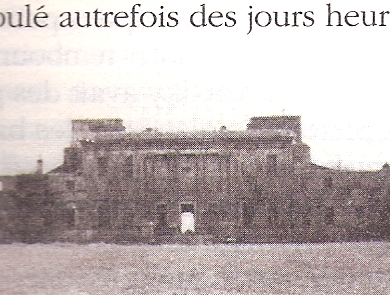Mike Davis, Dead cities, p.135:
« En effet ce qui se produisit dans le South Bronx – qui, comme le mettent en évidence les Wallace, « n’était même pas classé parmi les zones pauvres en 1967 » – ressemble étrangement aux deux dynamiques de mort décrites par Stewart dans Earth abides. Tout d’abord, tandis que la protection contre les incendies se dégradait, les propriétaires renoncèrent en masse à entretenir leurs bâtiments; ce qui, en retour, occasionna un accroissement de la fréquence des incendies. L’incinération rapide du coeur du South Bronx enfanta un exode de masse vers le West Bronx, où le surpeuplement, conjugué à la réduction continue des services d’incendies et des services du logement, mena à une deuxième vague de feux, qui se propagea aussi à Harlem et à certaines parties de Brooklyn. Après avoir culminé à 153 263 urgences en 1976 (alors que les incendies sérieux étaient trois fois supérieurs aux taux de 1964), la tempête de feu finit par s’épuiser d’elle-même; « le déclin des feux de structure après 1976, soulignent avec consternation les Wallace, ne représente pas la fin de la crise ou le renforcement des services d’incendie, mais plutôt la pure et simple pénurie de carburant dans les principales zones d’ « infection » incendiaire comme le South Bronx, Bushwick, etc. »
(Les prairies ordinaires, traduction de Maxime Boidy et Stéphane Roth)

Sebald, Les Anneaux de Saturne, p.201
« Notre propagation sur terre passe par la carbonisation des espèces végétales supérieures et, d’une manière plus générale, par l’incessante combustion de toutes substances combustibles. De la première lampe-tempête jusqu’aux réverbères du XVIIème siècle, et de la lueur des réverbères jusqu’au blême éclat des lampadaires qui éclairent les autoroutes belges, tout est combustion, et la combustion est le principe intime de tout objet fabriqué par nous. La confection d’un hameçon, la fabrication d’une tasse de porcelaine et la production d’une émission de télévision reposent au bout du compte sur le même processus de combustion. Les machines conçues par nous ont, comme nos corps et comme notre nostalgie, un coeur qui se consume lentement. Toute la civilisation n’a jamais été rien d’autre qu’un phénomène d’ignition plus intense d’une heure à l’autre et dont personne ne sait jusqu’où il peut croître ni à partir de quand il commencera à décliner. En attendant, nos villes rayonnent encore, les feux gagnent encore du terrain. »

Sebald, Les Anneaux de Saturne, p.189-190:
« De telles irruptions catastrophiques de la mer dans l’intérieur des terres se produisirent de manière répétée au cours des siècles suivants, et bien entendu, l’érosion de la côte s’accentua dans les intervalles calmes. La population de Dunwich se plia peu à peu à l’irréversibilité de cette évolution. Le combat était sans issue, on y renonça. On tourna le dos à la mer, et chaque fois que les moyens le permettaient, l’on bâtit vers l’ouest, prolongeant de génération en génération le processus de fuite en vertu duquel la ville qui se mourait lentement suivait – comme par réflexe, pourrait-on dire- l’un des mouvements fondamentaux de la vie humaine sur terre. Un nombre remarquablement élevé de nos agglomérations sont en effet tournées vers l’ouest et, pour peu que les conditions le permettent, s’étendent dans cette direction. L’est est synonyme d’absence d’issue. A l’époque de la colonisation du continent américain, notamment, on pouvait voir les villes se déployer vers l’ouest en même temps que les quartiers situés à l’est étaient abandonnés et tombaient en ruine. »
(Actes Sud, traduction de Patrick Charbonneau)

Dead cities examine la manière dont la guerre aérienne et les bombardements systématiques des populations civiles se sont imposés à l’esprit des stratèges britanniques puis américains comme un moyen efficace de remporter la seconde guerre mondiale; les trois courts essais qui composent le livre nous font découvrir le site de Dugway (étrange la consonance avec Dunwich), au milieu de l’Utah, où fut élevé un quartier Potemkine dont les Mietzkazerne n’avaient été construites en 1942 – d’après le modèle des immeubles berlinois – que pour étudier les ravages du feu et accélérer les incendies des grands ensembles ouvriers de la capitale allemande.

 Ils racontent aussi la destruction par les flammes de blocs entiers de New York, l’effondrement des tours du World Trade Center, la progression de nouvelles espèces végétales, comme le buddleia davidii,
Ils racontent aussi la destruction par les flammes de blocs entiers de New York, l’effondrement des tours du World Trade Center, la progression de nouvelles espèces végétales, comme le buddleia davidii, dans les ruines des villes allemandes bombardées. L’ouvrage présente les tableaux apocalyptiques de romans d’anticipation comme After London de Richard Jefferies (1885), A Crystal Age, de William Henry Hudson (1887), Nouvelles de nulle part de William Morris (1890), la Guerre des airs d’H. G. Wells (1898). De la même crise fin de siècle il convoque les figures de Nietzsche et de Freud. Plus près de nous l’auteur se ressource aux utopies d’Ernst Bloch et rend hommage au travail photographique de Camilo Vergara, l’un des seuls à avoir archivé par ses clichés la progression des ruines qui a dévasté le Bronx et Harlem au coeur des années 1970.
dans les ruines des villes allemandes bombardées. L’ouvrage présente les tableaux apocalyptiques de romans d’anticipation comme After London de Richard Jefferies (1885), A Crystal Age, de William Henry Hudson (1887), Nouvelles de nulle part de William Morris (1890), la Guerre des airs d’H. G. Wells (1898). De la même crise fin de siècle il convoque les figures de Nietzsche et de Freud. Plus près de nous l’auteur se ressource aux utopies d’Ernst Bloch et rend hommage au travail photographique de Camilo Vergara, l’un des seuls à avoir archivé par ses clichés la progression des ruines qui a dévasté le Bronx et Harlem au coeur des années 1970.

Mike Davis incarne le rêve américain et son revers: ancien ouvrier des abattoirs, ancien camionneur, il est devenu, après avoir découvert Marx, professeur d’université, suivant le parcours inverse (à l’européenne pourrait-on dire) de Sebald, passé de l’Alma mater à la vie d’écrivain. Il fait partie de ces self-made-writers passés par tous les petits boulots, devenus les contempteurs de l’Amérique: Charles Bukowski, John Fante, Joseph Heller, Raymond Carver, la liste est aussi longue que celle des jobs complaisamment égrenés en quatrième de couverture et dans les ouvertures d’articles élogieux.
Ses études proposent des analyses hybrides et novatrices, mêlant des considérations classiques sur le zoning, les politiques fiscales, la géopolitique, à un usage décomplexé de la fiction. On retrouve le plaisir romanesque que l’on ressentait déjà à la lecture de son City of Quartz (1997) dans lequel il mettait en scène le Los Angeles des écrivains (The Day of the Locust de Nathanael West) moins pour tirer l’analyse froide des représentations d’une ville (Mike Davis ne fait pas de géographie littéraire) que pour appuyer un discours moral, parfois moralisateur, sur les dérives urbaines. Ses travaux ont eu le mérite de donner une résonance médiatique à bon nombre de sujets longtemps cantonnés à quelques niches académiques -le phénomène des nimbies (« Not in my backyard! ») dans City of Quartz; les interactions insoupçonnées entre nature et ville et la dimension géomorphologique de nos ponctions dans le sous-sol terrestre dans Villes mortes. On ne regarde pas la ville tout à fait de la même manière après ses révélations.
Dead cities, p.73:
« Depuis la fin du XIXème siècle environ, la majeure partie de l’énergie à disposition de la race humaine a été investie dans la construction et l’entretien de l’habitat urbain. Objet premier du travail humain et animal depuis huit mille ans, l’agriculture est aujourd’hui secondaire comparée au drame (littéralement) « géologique » de l’urbanisation. Les géologues estiment que l’énergie fossile actuellement dévolue à l’aménagement de la surface terrestre pour les besoins d’une population humaine de citadins en pleine explosion est géomorphologiquement équivalente, du moins à court terme, aux formes premières de l’activité tectonique planétaire: la dérive des continents et l’érosion des reliefs. »
L’idée que l’on peut faire une « histoire naturelle » de la construction et de la destruction n’est pas très éloignée des préoccupations de Sebald. Le passage sur les villes bombardées rappelle les conférences de Zurich réunies en français sous le titre De la destruction comme éléments de l’histoire naturelle. La modernité occidentale, en tournant le dos (vers l’ouest donc…) à la nature et en refusant de considérer la destruction à l’œuvre, a fait de bien des parties du monde un enfer qui fait regretter le Paradis perdu. On lit une vision orientée et prophétique (apocalyptique: une révélation) de l’histoire, considérée comme un processus d’ignition inéluctable, même si, à la différence de Sebald (chez qui le marxisme est pour le moins discret, même s’il affleure à l’occasion de descriptions de Manchester par exemple), les responsabilités du désastre sont plus clairement attribuées aux élites politiques et économiques. L’attention portée au phénomène de combustion semble-t-il spontané fait penser à bien des passages des Anneaux de Saturne. Quant au sermon, on l’entend aussi dans Austerlitz.

Sebald, Austerlitz, p.64
« J’étais déjà au lit et Elias, assis sur un tabouret près de la fenêtre, contempla encore très longtemps ce spectacle en silence. Je crois que c’est la vision de cette vallée soudain éclairée par l’éclat du feu puis plongeant de nouveau dans les ténèbres qui lui inspira le sermon du lendemain, sur le thème de la vengeance du Seigneur, de la guerre et de la dévastation des lieux habités par les hommes, un sermon dans lequel, comme le lui dit le marguillier au moment des adieux, il s’était surpassé. O combien. L’auditoire, pendant le sermon, avait été pétrifié d’effroi, mais pour ma part la violence dépeinte par Elias n’aurait pas à ce point marqué mon esprit si dans la petite ville au sortir de la vallée, où le soir même le prédicateur devait présider à la prière, une bombe n’était tombée en plein après-midi sur le bâtiment abritant le cinéma. Les ruines fumaient encore quand nous arrivâmes. Les gens formaient des grappes dans la rue, beaucoup, horrifiés, sous l’emprise de l’émotion masquaient encore leur bouche de la main? Les pompiers étaient arrivés, écrasant avec leur voiture le massif de fleurs, et sur la pelouse, en habits du dimanche, gisaient les corps de ceux qui, Elias n’avait pas eu besoin de me le dire pour que je le comprenne, avaient péché en enfreignant le commandement sacré du sabbat. Peu à peu s’élabora dans ma tête une sorte de mythologie inspirée des représailles de l’Ancien Testament, dont au demeurant la pièce maîtresse a toujours été l’engloutissement de la commune de Llanwddyn dans les eaux du lac de Vyrnwy. »
La prose de Davis ne parvient pourtant pas toujours à s’élever au dessus des décombres comme celle de Benjamin et de Sebald. Les essais se lisent sans déplaisir: sa plume imprécatrice et son talent de conteur (il faut lire le récit de la fondation de Los Angeles dans City of Quartz) lui ont assuré un succès peu commun dans le monde universitaire. Mais l’auteur a parfois la main lourde. Les descriptions n’échappent pas toujours à la grandiloquence et, c’est peut-être ce qui l’éloigne le plus de l’auteur des Anneaux de Saturne (quoique..), on a parfois le sentiment qu’elles trahissent le plaisir ambigu que le prêcheur peut ressentir, de sa chaire, à raconter l’apocalypse devant des fidèles médusés.
L’analyse elle-même prête à discussion. La perspective est géographiquement et historiquement large mais les études de cas étroites, les travaux sont souvent de seconde main et anciens (par exemple sur les articles des époux Wallace), le biais idéologique marxiste a ses vertus et ses faiblesses. Les réflexions sur le 11 septembre -une punition méritée et un ironique accomplissement des fantasmes organisés pendant des décennies par Hollywood au service des puissants- sont discutables et de peu d’intérêt scientifique. Le détour par les oeuvres d’anticipation offre des perspectives nouvelles et éclairantes, mais menace de tomber dans le ridicule quand les récits sont utilisés comme éléments de preuve et leurs auteurs comme des voyants, davantage que comme les témoins des angoisses d’une époque et d’un lieu.

La vision de cet universitaire progressiste ou « radical » (selon les étiquettes américaines) a finalement une dimension antimoderne (mais c’est toute la contre-culture américaine qui plonge une partie de ses racines dans les mythes originels de l’Amérique rurale des Pères fondateurs). Mike Davis est un puritain, qui pense que les villes américaines incarnent une faute originelle. On n’est pas étonné de trouver sous sa plume des auteurs comme Ruskin qui, à la fin du 19ème siècle qualifiait la ville industrielle de « métropole toxique » et prédisait la disparition de la population anglaise dans un nuage empoisonné. On comprend ce qui l’attire dans After London de Jefferies où la nature sauvage (mais n’est-ce pas aussi l’Angleterre « verte », aristocratique?) triomphe de Londres la populeuse et toxique (p.90). La destruction des villes apparaît comme la juste punition et la revanche de la nature sur les dérives prométhéennes de la modernité, considérations dont on voit assez facilement ce qu’elles peuvent avoir – utilisées par d’autres, et à d’autres fins – de réactionnaires. Davis ne cache d’ailleurs pas les prolongements, bien éloignés de ses propres valeurs, auxquels a pu aboutir ce genre de déploration. Il rappelle ainsi l’existence des « utopies » éco-fascistes en vogue pendant la guerre au sein de certains cercles nazis. Leurs membres accueillaient avec un certain contentement les bombardements alliés et prévoyaient la disparition de la grande métropole « juive » au profit de villes-jardins bien aryennes.
Dead cities touche moins, on le voit, par la rigueur de sa démonstration que par l’originalité de son objet d’étude, l’outrance et la beauté un peu archaïques de sa prose, qui en font un étonnant recueil d’exempla à l’usage des laïcs du XXIème siècle.
Note:
Pour une critique plus approfondie et académique du travail de Davis, lire la recension qu’a faite Cynthia Ghorra-Gobin d’un autre de ses ouvrages: Paradis infernaux (écrit en collaboration avec Daniel B. Monk)
(Images: Photographies de Harlem et du Bronx par Camilio Vergara, Un puritain admonestant ses compagnons aux Etats-Unis, vers 1620, par Howard Pyle (1853 – 1911); John Ruskin, par John Millais, 1854)




 Publié par Sebastien Chevalier
Publié par Sebastien Chevalier